|
|
|

LES LIBATIONS.
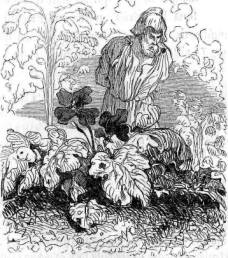 ercure
Cyllénien(1) évoque
les âmes des prétendants
en tenant dans sa main droite
une belle verge d'or avec
laquelle il peut, à son
gré, fermer les yeux des
humains ou dissiper le
sommeil éternel ; il les chasse et
les conduit avec cette
verge, et les âmes le suivent
en poussant de faibles
cris. De même que des
oiseaux nocturnes,
voltigeant dans un antre obscur et sacré, font entendre des sons
perçants et lugubres lorsque
l'un d'eux est tombé du haut de la
roche où ils étaient tous réunis : de même les âmes des morts font entendre un bruit semblable en voltigeant dans les ténèbres
et en suivant le bienveillant Mercure qui les conduit dans les
sombres sentiers. Elles franchissent les flots de l'Océan, le rocher
de Leucade, les portes du Soleil, la demeure des Songes, et elles
arrivent bientôt à la prairie Asphodèle où résident les âmes qui
ne sont que les ombres des morts. ercure
Cyllénien(1) évoque
les âmes des prétendants
en tenant dans sa main droite
une belle verge d'or avec
laquelle il peut, à son
gré, fermer les yeux des
humains ou dissiper le
sommeil éternel ; il les chasse et
les conduit avec cette
verge, et les âmes le suivent
en poussant de faibles
cris. De même que des
oiseaux nocturnes,
voltigeant dans un antre obscur et sacré, font entendre des sons
perçants et lugubres lorsque
l'un d'eux est tombé du haut de la
roche où ils étaient tous réunis : de même les âmes des morts font entendre un bruit semblable en voltigeant dans les ténèbres
et en suivant le bienveillant Mercure qui les conduit dans les
sombres sentiers. Elles franchissent les flots de l'Océan, le rocher
de Leucade, les portes du Soleil, la demeure des Songes, et elles
arrivent bientôt à la prairie Asphodèle où résident les âmes qui
ne sont que les ombres des morts.
Elles
aperçoivent bientôt l'âme d'Achille, fils de Pelée, celles de Patrocle,
de l'irréprochable Antiloque et d'Ajax, d'Ajax qui, par sa
taille et sa beauté, l'emportait sur tous les Danaens, excepté sur
l'illustre fils de Pelée. Tous ces héros sont réunis autour d'Achille.
En ce moment arrive, accablée de tristesse, l'âme d'Agamemnon
;
elle est suivie des ombres de tous les guerriers qui succombèrent
dans le palais d'Égisthe, avec le fils d'Atrée. Alors
le vaillant Achille s'écrie :
«
Agamemnon, nous pensions que le dieu qui se plaît à lancer la
foudre te protégerait entre tous les héros, parce que tu commandais
à de braves et nombreux guerriers dans les plaines de Troie
où les Achéens ont souffert des maux sans nombre ! Cependant
toi, l'un
des premiers, tu as été victime
de cette destinée funeste à laquelle nul mortel ne peut échapper ! Ah ! que n'as-tu péri
au milieu des Troyens et dans tout l'éclat de ton triomphe ! Les
Grecs auraient élevé une tombe à ta mémoire, et tu aurais laissé à ton fils une gloire immortelle ! Mais le destin t'a réservé la
mort la plus déplorable ! »
L'âme
d'Atride lui répond aussitôt :
«
Heureux fils de Pelée, Achille semblable aux dieux, toi , du
moins, tu succombas devant Ilion, et loin d'Argos, ta patrie ! Les
plus braves d'entre les Grecs et les Troyens tombèrent autour de
toi en se disputant ton cadavre ! Tu gisais noblement sous des
tourbillons de poussière; car déjà tu avais oublié l'art de
conduire les chevaux et les chars ! Nous combattîmes tout le
jour pour défendre ton corps, et
peut-être nous n'eussions point cessé de combattre,
si Jupiter ne nous eût forcés de nous retirer en nous envoyant
une horrible tempête. Nous t'enlevâmes du champ du combat ;
nous te portâmes sur un de nos vaisseaux, et,
après avoir baigné et parfumé
d'essences ton beau corps, nous le déposâmes sur un lit funèbre.
Tous les fils de Danaus, réunis autour
de ce lit, fondaient en larmes et coupaient leur belle chevelure.
En apprenant cette fatale nouvelle, ta mère, accompagnée des nymphes des eaux, sortit du sein de l'Océan : les vagues s'agitèrent
avec bruit et remplirent d'une telle crainte les guerriers achéens,
qu'ils se seraient éloignés sur leurs creux navires si Nestor,
le plus sage de tous les héros, Nestor, dont on avait toujours admiré
l'expérience et les conseils, ne les eût retenus en leur disant avec
bienveillance :
«
Arrêtez-vous, nobles Argiens ! Ne fuyez donc point, vaillants fils
des Grecs ! C'est la mère d'Achille et les nymphes immortelles
de la mer qui sortent du sein des ondes pour rendre les derniers
honneurs au divin fils de Pelée. »
A
ces mots les magnanimes Achéens s'arrêtèrent. Les filles du
vieillard de la mer entourèrent ton corps en versant des larmes et te
revêtirent de célestes vêtements(2) ; les neuf Muses déplorèrent ton
trépas en faisant entendre tour à tour leurs voix mélodieuses ; et
l'on ne voyait aucun Grec qui ne répandît des pleurs : ils étaient
tous émus par les chants plaintifs des Muses divines. Pendant dix-sept
jours et dix-sept nuits, les dieux immortels et les faibles humains
te pleurèrent. Mais lorsque la dix-huitième aurore eut brillé dans
les cieux, nous dressâmes un bûcher autour duquel nous immolâmes
de grasses brebis et des bœufs aux cornes recourbées. Ton corps,
revêtu de vêtements célestes et entouré de miel et d'huiles parfumées,
se consuma en présence d'un grand nombre de héros, cavaliers et
fantassins, qui portaient vaillamment leurs armures et faisaient
le tour du bûcher avec un bruit qui fit retentir toute la plaine.
Le lendemain, lorsque les flammes de Vulcain t'eurent consumé,
nous recueillîmes tes ossements blanchis, et,
après les avoir
arrosés de vin et d'huile, nous les renfermâmes dans une urne
d'or que ta mère nous apporta en disant que cette urne, travaillée
par l'illustre Vulcain, lui avait été donnée par Bacchus. Noble
Achille, c'est dans cette urne que reposent tes os, confondus
avec ceux de Patrocle, fils de Ménétius ; les cendres d'Antiloque, de celui qui fut après Patrocle l'ami le plus cher à ton cœur,
ont été mises à part. La vaillante armée des Argiens éleva sur
ces précieux restes un tombeau magnifique qui, placé sur les rives
de l'Hellespont, domine au loin la vaste mer. Ce monument,
qu'aperçoivent maintenant tous les navigateurs, doit aussi frapper les regards de ceux qui
naîtront dans l'avenir. Ta mère apporta dans la lice des prix superbes qu'elle avait obtenus
des dieux et
qu'elle destinait aux plus braves des Achéens(3). J'ai assisté
souvent aux funérailles des héros
;
j'ai vu aussi, à la mort
des rois, les jeunes gens se ceindre pour la lutte ; et cependant mon âme a
été frappée d'admiration en apercevant les prix magnifiques
qui avaient été offerts en ton honneur par ta noble mère, Thétis
aux pieds d'argent ! On voyait bien que tu étais
chéri des immortels. Noble Achille, ton nom ne périra pas, même
après ta mort, et ta gloire brillera toujours parmi les hommes
!
Mais moi, qu'ai-je
gagné à terminer glorieusement la guerre contre les Troyens ?
Jupiter, à mon retour, m'a fait tomber sous les coups de l'infâme Égisthe
et m'a livré aux fureurs de ma
perfide épouse !»
Ils
s'entretenaient encore lorsque Mercure(4), conduisant les
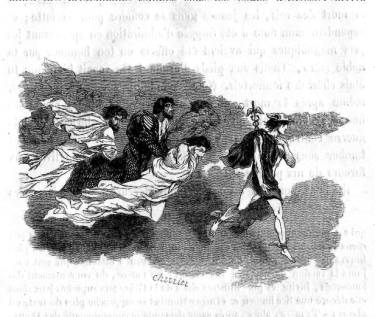
âmes
des prétendants tombés sous les
coups d'Ulysse, arriva
près
des héros. Ceux-ci, frappés d'étonnement, allèrent à leur rencontre. L'ombre d'Agamemnon reconnaît aussitôt celle de l'illustre
Amphimédon, fils de Mélanée : il reçut l'hospitalité de ce
jeune prince lorsqu'il vint à Ithaque, et demeura dans son palais. Le fils d'Atrée lui parle en ces termes :
«
Amphimédon, quel accident funeste a donc envoyé au séjour des
ténèbres des héros d'un rang si distingué, des jeunes princes du
même âge ? Certes, on ne pourrait trouver dans une seule et
même ville des guerriers aussi vaillants que vous. Est-ce que Neptune
vous aurait immolés dans vos navires en excitant contre vous les
horribles tempêtes et les vagues immenses ? Des peuples étrangers
vous auraient-ils donné la mort tandis que vous vous empariez
de leurs bœufs et de leurs brebis, ou que vous combattiez
pour la défense de votre ville et de vos femmes ? Amphimédon,
réponds à mes questions ; car je fus autrefois ton hôte. Ne
te souvient-il plus du jour où te me reçus dans ton palais, quand,
suivi du divin Ménélas, j'allais presser Ulysse de partir avec nous
pour Ilion sur ses navires aux beaux tillacs ? Ce ne fut qu'un mois après
avoir franchi la vaste mer que nous parvînmes à persuader
Ulysse, le destructeur des villes, de nous accompagner. »
L'âme
d'Amphimédon lui répond en disant :
«
Glorieux descendant d'Atrée, Agamemnon, roi des hommes, je
me rappelle tout ce que tu viens de me dire.
Maintenant, ô fils chéri
de Jupiter, je vais le raconter comment la mort terrible nous
a tous atteints. Nous désirions obtenir pour épouse la femme du
vaillant Ulysse, absent depuis longtemps. Pénélope, sans
vouloir accepter ni refuser
cet hymen qui lui était odieux, machinait en secret notre
perte ; et entre autres
ruses, en voici une
qu'elle imagina. Elle se mit dans son palais à tresser une toile d'un
tissu délicat, d'une grandeur immense,
et elle nous dit : «
Jeunes gens, qui prétendez à ma main, puisque le divin Ulysse a
péri, différez mon mariage jusqu'au jour où j'aurai terminé ce voile funèbre que je destine au héros Laërte (puissent mes travaux
n'être pas entièrement perdus !) lorsque le triste destin l'aura, plongé dans le
long sommeil de la mort, afin
qu'aucune femme, parmi
le peuple, ne s'indigne contre moi, s'il reposait sans linceul,
celui qui posséda tant de richesses. » C'est ainsi qu'elle parlait,
et nous crûmes à ses paroles. Durant
le jour elle tissait cette grande toile ; mais le soir, à la lueur
des flambeaux, elle détruisait
son ouvrage. Pendant
trois années elle se cacha au moyen de cette ruse et parvint
à persuader les Grecs. Mais, quand les Heures, dans leur cours,
eurent amené la quatrième année,
et que bien des jours et des nuits se furent écoulés, une esclave
infidèle nous apprit cette ruse. Nous trouvâmes Pénélope détruisant
ses travaux ; alors nous la forçâmes d'achever ce grand voile.
Quand elle l'eut terminé et lavé, il brillait comme les rayons du soleil et il
était semblable à la douce clarté de la lune. Alors un
mauvais génie(5) ramena Ulysse dans l'étable qu'habitait le
gardien
des porcs, et qui était située à l'extrémité des champs. Son fils
Télémaque y vint aussi à son retour de la sablonneuse Pylos
sur son sombre navire. Ces deux princes, après avoir médité le trépas
des prétendants, se rendirent dans la célèbre ville d'Ithaque
: Télémaque y arriva le premier et Ulysse suivit ses pas. Le roi,
sous les traits d'un vieillard
couvert de haillons et appuyé sur un bâton comme un misérable
mendiant, avait pour guide le pasteur
Eumée ; il se présenta ainsi dans son palais,
et aucun de nous ne put le reconnaître, même parmi ceux qui étaient les plus âgés.
Nous accablâmes Ulysse de coups et d'injures ; mais il supporta
patiemment ces sanglants outrages. Ce héros, inspiré par Jupiter,
prit, avec son fils Télémaque, toutes les armes de la salle
du festin, les déposa dans les appartements supérieurs, et ferma
toutes les portes avec soin. Ensuite, par un adroit stratagème,
il ordonna à son épouse de nous apporter l'arc et le fer brillant,
et de nous proposer cette épreuve fatale qui devint la cause
de notre mort : nous fûmes tous trop faibles pour tendre le
nerf de l'arc redoutable ! Quand on voulut remettre l'arme entre les mains d'Ulysse, nous nous y opposâmes tous ; nous adressâmes
des injures au gardien des porcs et nous lui défendîmes
de la donner à ce mendiant malgré ses instances. Mais aussitôt Télémaque commanda au pasteur d'obéir à l'étranger. Dès que
le divin Ulysse eut son arc,
il le tendit sans effort et lança une
flèche à travers le fer ; puis il se plaça sur le seuil de la porte, répandit à ses pieds les traits rapides, nous regarda tous
d'un air menaçant
et perça d'une flèche le roi Antinoüs. Le héros
frappa ensuite les fiers prétendants, et ils tombèrent tous les uns
sur les autres. Certes, un dieu favorisait alors Ulysse et ses
compagnons ! Nos ennemis, obéissant à la voix de leur chef, se précipitèrent
dans la salle et immolèrent tous ceux d'entre nous qui étaient
encore vivants. Quel affreux spectacle ! Le palais retentissait
des horribles gémissements de
ceux qu'on égorgeait, du bruit
que faisaient les crânes en se brisant
;
et le sang coulait à longs
flots sur les pavés de la salle ! Puissant Agamemnon, voilà comment
nous avons tous péri. Nos cadavres sont maintenant étendus sans sépulture dans le palais d'Ulysse, car la nouvelle de notre
mort n'est pas encore connue de nos amis et de nos parents ; sans
cela ils auraient quitté leurs belles demeures pour laver le sang
de nos blessures, pour déposer nos corps sur des bûchers, et
pour nous rendre les honneurs que l'on doit à ceux qui ne sont
plus.»
L'ombre
d'Atride s'écrie aussitôt :
«
Heureux fils de Laërte, ingénieux Ulysse, tu possèdes une femme
d'une grande vertu!
Quelle prudence et quelle sagesse dans
l'irréprochable fille d'Icare ! Quelle fidélité pour son premier époux
! La renommée de sa vertu ne périra jamais, et les immortels inspireront aux hommes de gracieux chants pour éterniser
sur la terre la mémoire de la chaste Pénélope ! Elle n'a point
agi comme la fille de Tyndare, qui commit les plus odieux forfaits
en immolant son premier époux : des chants lugubres en gardent le souvenir parmi les humains, et son crime a flétri pour
jamais toutes les femmes, même les plus vertueuses ! »
Les
ombres des morts s'entretiennent ainsi sous la terre, dans les
ténébreuses demeures de Pluton.
Cependant
Ulysse et ses compagnons étaient sortis de la cité d'Ithaque
et se rendaient aux fertiles campagnes que le vieux Laërte
possédait après avoir souffert bien des peines. Là était la demeure de ce héros : tout autour de cette maison se trouvait une
galerie(6) où les serviteurs prenaient leur repas, se reposaient
le
jour
et dormaient la
nuit. Auprès de Laërte
était
une vénérable
Sicilienne
qui
lui
prodiguait les soins les plus
tendres dans cette
campagne éloignée de la ville. Ulysse s'arrête en ces
lieux,
et,
s'adressant à ses compagnons, il
leur dit
:
«
Entrez maintenant dans la belle demeure, et préparez promptement
pour notre repas le porc le plus gras du troupeau. Moi
je vais me
rendre auprès de mon vieux père pour voir
si, après une telle
absence, il me reconnaîtra lorsque je m'offrirai à ses regards.
»
En
disant
ces mots, il remet aux pasteurs
ses armes redoutables ;
ils entrent tous dans la demeure de Laërte, et Ulysse traverse
le verger pour se rendre auprès de son père. Le héros, en
parcourant le vaste jardin, ne rencontre ni Dolius, ni les fils de
Dolius, ni même aucun des esclaves : conduits par le vieux serviteur,
ils étaient allés chercher des
buissons pour fermer l'enceinte du jardin. Il trouve son père seul, occupé dans le verger
fertile à creuser la terre autour d'une plante : une tunique sale,
grossière et rapiécée couvrait son corps ; de pauvres cnémides
en cuir de bœuf entouraient ses jambes pour les préserver des épines ; sur ses mains étaient des gants(7), à cause des ronces, et,
pour compléter son vêtement de deuil, le vieux Laërte portait
sur la tête un bonnet de peau de chèvre. Quand le divin Ulysse
voit son père accablé de vieillesse et dans un abattement
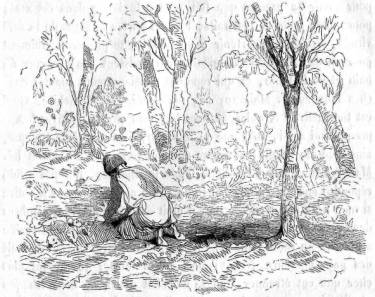
qui
indiquait un profond chagrin ; il s'arrête sous un haut poirier et
se met à fondre en larmes. Il se demande s'il ira
droit à son père, s'il l'embrassera et lui racontera comment il est revenu dans
sa patrie, ou
s'il l'interrogera avant de se faire connaître, pour
lui ménager
une douce surprise (8) : ce dernier parti lui semble préférable.
Il s'approche donc de son père pour l'éprouver en lui adressant
quelques faibles reproches. Laërte, la tête baissée, remuait
la terre autour d'une plante. Ulysse se présente à son père
et lui dit :
«
Vieillard, je vois que tu ne manques pas d'expérience,
et que tu as le plus grand
soin de Ion jardin. Ces plantes,
ces figuiers, ces vignes,
ces oliviers ces poiriers,
ces plants de jardinage, tous ces arbres, en un mot, sont parfaitement entretenus.
Cependant je me permettrai de te dire (et
ne va pas t'irriter
contre moi)
que tu ne soignes pas assez ta
personne : tu es à la fois vieux,
sale et mal vêtu. Ce n'est pas du moins pour punir ta paresse que ton
maître te laisse dans cet état ; pourtant ta taille et tes traits, loin de porter le signe de la
servitude,
semblent appartenir à un roi. On te prendrait vraiment pour
un de ces heureux vieillards
qui jouissent des charmes du bain
et de la table, et qui reposent délicieusement sur des couches
moelleuses. Mais voyons, parle-moi avec franchise. Quel est
ton maître ? A qui appartient le jardin que tu cultives ? Apprends-moi aussi, pour que je le sache, si je suis dans Ithaque, ainsi
que me l'a dit un homme que j'ai
rencontré en venant ici. Mais
cet homme, doué d'une faible intelligence, n'a pas voulu répondre aux autres questions que je lui ai adressées et me dire si
mon hôte vivait encore ou s'il était
descendu dans les sombres demeures
de Pluton. Écoute, vieillard, et prête-moi une oreille attentive. Je reçus jadis dans mon palais un étranger qui arrivait des
pays lointains. Non, jamais aucun mortel ne me fut plus cher que cet
étranger, qui se glorifiait d'être né dans Ithaque et
d'avoir pour père Laërte, fils d'Artésius ! Je l'accueillis chez moi
avec bienveillance ; je lui prodiguai tous les biens que je possédais,
et je lui fis, selon l'usage, les présents de l'hospitalité.
Je lui donnai sept talents d'or travaillés
avec art,
un cratère
d'argent émaillé de fleurs(9), douze couvertures simples(10), douze
tapis, douze
manteaux et douze tuniques. Je lui donnai encore
quatre femmes belles, savantes, et qu'il avait lui-même choisies.
»
Son
père lui répond en versant des larmes :
« Étranger, tu es en effet dans le pays que tu viens de nommer
; mais il est gouverné maintenant par des hommes insolents et
pervers. C'est en vain que tu as prodigué tant de présents : ton hôte
n'est plus. Si tu l'avais trouvé encore vivant au milieu du peuple
d'Ithaque, il t'aurait donné l'hospitalité à son tour
et t'aurait
comblé de dons précieux avant de
te renvoyer dans ta patrie. Il faut toujours récompenser ceux
qui nous ont fait du bien. Mais
parle-moi sincèrement ; dis-moi
combien il s'est
écoulé d'années depuis que tu as reçu ton hôte,
mon fils, le plus infortuné de tous les mortels(11)
! Sans doute loin
de ses amis et de sa patrie,
il a été,
dans l'Océan, la pâture des poissons, ou sur la terre la proie des
bêtes sauvages et des vautours !
Son père et sa mère n'ont point versé de larmes en lui rendant les
derniers devoirs ! La chaste Pénélope n'a point pleuré sur le lit
funèbre de son époux et n'a pu,
selon l'usage, lui fermer les yeux ! Enfin, il n'a reçu aucun des
honneurs que l'on doit aux morts !... Étranger, réponds encore à mes
questions. Dis-moi qui tu es, quelle est ta patrie et quels sont tes
parents ? Dis-moi où tu as laissé
le vaisseau rapide qui t'a conduit ici, et quels sont tes
compagnons ? Es-tu venu sur un navire étranger, et les rameurs qui t'ont déposé sur nos côtes sont-ils déjà
partis ? »
L'ingénieux
Ulysse lui répond en disant :
«
Vieillard, je te parlerai avec franchise. Je suis d'Alybante où
j'habite le superbe palais de mon père Aphidante, fils de Polypémon,
et mon nom est Épéritus. Un mauvais génie, qui me
fait errer depuis long-temps loin de la Sicanie, m'a conduit malgré
moi sur les bords d'Ithaque, et mon navire est resté sur le rivage, à quelque distance de la ville. Il y a déjà cinq années que
le malheureux Ulysse a quitté ma patrie. Quand ce héros partit d'Alybante, des oiseaux de bon augure volèrent à sa droite ; nous
nous réjouîmes tous deux de ce présage, car nous espérions nous revoir un jour et nous faire encore de nouveaux présents.
»
Il dit,
et le sombre nuage de la douleur obscurcit le front du
pauvre vieillard. Laërte se baisse lentement,
ramasse de la poussière brûlante
et la jette à pleines mains
sur sa tête en poussant de sourds gémissements. A cette vue le cœur d'Ulysse se déchire
et ses narines se gonflent : saisi d'une
vive émotion, le héros se précipite dans les bras du vieillard, le couvre de baisers
et lui dit :
«
Mon père,
c'est moi,
c'est ton fils, celui que tu
regrettes, et qui, après
vingt années d'absence, revient enfin dans sa chère
patrie ! O mon père, sèche tes larmes et retiens tes sanglots ; car j'ai
à te dire (et le temps nous presse) que je viens d'immoler dans
mon palais tous les prétendants de Pénélope, que je viens de
châtier l'insolence de ces jeunes princes, et de les punir de
leurs forfaits odieux ! »
Le
vieux Laërte lui répond aussitôt :
«
Si vraiment tu es mon fils, mon Ulysse bien-aimé, montre-moi
donc quelque signe certain qui puisse m'en convaincre. »
L'ingénieux
Ulysse réplique en ces termes :
«
Eh bien ! contemple de tes propres yeux la cicatrice de la blessure que me fit jadis,
sur le mont Parnèse, un sanglier aux
dents d'ivoire lorsque j'allai,
par ton ordre et par celui de ma mère,
auprès d'Autolycus, mon aïeul maternel, pour chercher les
dons qu'il avait promis de me donner quand il vint à Ithaque. Mais pour dissiper tes doutes, ô mon père, je vais maintenant te
désigner, dans ce magnifique jardin, les arbres que tu me donnas
pendant mon enfance lorsque je t'accompagnais sous ces beaux
ombrages et que tu me disais le nom des arbres de ton jardin.
Tu me fis présent de treize poiriers, de dix pommiers et de quarante
figuiers ; tu me promis en outre cinquante treilles de vignes
dont chacune était chargée de grappes
diverses(12) qui mûrissent
lorsque
les saisons de Jupiter descendues
des cieux s'appesantissent
sur elles. »
A
ces paroles et à ces indices,
le vieillard
sent ses genoux trembler
et son cœur défaillir ; car il vient de reconnaître son fils. Il se
jette en
chancelant dans les bras d'Ulysse, et le héros soutient son
père prêt à s'évanouir.
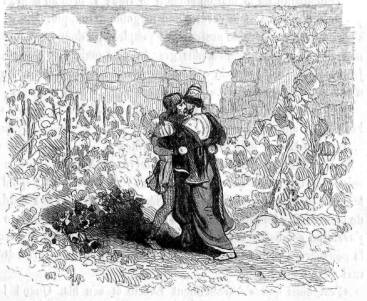
Quand le vieux
Laërte est revenu de
sa faiblesse et que
le trouble de son esprit
s'est dissipé, il s'écrie avec
transport :
«
Puissant Jupiter, et vous,
dieux de l'Olympe, vous régnez toujours
dans les cieux, puisque les orgueilleux prétendants ont expié
leurs crimes ! Je crains à présent que les habitants d'Ithaque ne viennent nous surprendre, et qu'ils n'envoient des messagers dans
toutes les villes des Céphalléniens. »
L'ingénieux
Ulysse lui répond aussitôt :
«
Rassure-toi, ô mon père, et que de telles pensées ne troublent
point ton âme. Allons maintenant dans ta demeure, située près
du verger ; là, Télémaque,
Eumée et Philétius nous préparent
un repas. »
Ils
se dirigent tous deux vers l'habitation du vieux Laërte. A leur
arrivée ils trouvent Télémaque et les deux pasteurs coupant les
viandes et mêlant dans des cratères un vin aux sombres couleurs.
L'intendante
de la maison conduit le vieux Laërte au bain, le parfume
d'essence et le revêt d'une magnifique tunique. Minerve s'approche du
vénérable pasteur des peuples, lui donne une force nouvelle
et le fait paraître plus grand , plus majestueux et plus jeune. Laërte
sort du bain et se montre à son fils tout rayonnant d'une
beauté céleste. Ulysse, en l'apercevant, lui dit :
«
O mon père, il n'y
a qu'un immortel qui ait pu te
rendre si beau, si grand et si jeune ! »
Le
sage Laërte lui répond en ces termes :
«
Puissant Jupiter, et vous, Minerve et Apollon, que ne suis-je
à présent ce que je fus lorsque, régnant sur les Céphalléniens,
je pris la superbe ville de
Nérice,
située près des bords de
la mer ! Si, tel que j'étais alors et portant encore mon armure, j'avais
pu combattre à tes côtés, ô mon fils, j'aurais fait mordre la
poussière à plus d'un prétendant, et toi,
Ulysse, tu aurais été ravi
de me voir ! »
C'est
ainsi que s'entretiennent Laërte et son fils. Quand le repas
est préparé, ils s'asseyent tous en ordre sur des sièges et sur
des trônes, et portent les mains aux mets qui leur ont été servis.
Dolius et ses fils reviennent fatigués des champs : la vénérable
Sicilienne, leur mère, qui prodiguait les soins les plus tendres
au vieux Dolius, depuis qu'il était courbé sous le poids des ans,
avait été les appeler. Dès qu'ils aperçoivent Ulysse, ils le reconnaissent
aussitôt, et, frappés d'étonnement, ils restent immobiles sur le
seuil de la porte. Le héros, s'adressant à Dolius, lui
dit avec douceur :
«
Vieillard, assieds-toi à notre table et reviens de ta surprise.
Il y
a longtemps que nous désirions prendre ici quelque nourriture,
et nous t'attendions pour commencer
notre repas. »
A
peine a-t-il prononcé ces paroles, que Dolius se jette dans les bras
d'Ulysse,
lui baise
les mains, et lui dit :
«
Cher maître, puisque vous êtes enfin revenu selon nos désirs
(pourtant nous n'espérions plus vous revoir)
;
puisque les dieux vous ont ramené dans votre patrie, soyez heureux ; réjouissez-vous, et que les immortels vous comblent de félicités ! Mais dites-moi
si votre épouse, la chaste Pénélope, est instruite de votre
retour, ou si nous devons lui annoncer cette heureuse nouvelle.
»
L'ingénieux
Ulysse lui répond aussitôt :
«
Vieillard, Pénélope sait mon arrivée ; ainsi ne t'occupe pas du
soin de la prévenir(13). »
Il
dit,
et Dolius s'assied sur un siège
magnifique. Les fils du vieillard adressent à leur tour de
respectueuses paroles au divin Ulysse,
et lui baisent les mains ; puis ils se placent auprès de leur père.
Alors tous les convives se livrent aux plaisirs du festin dans la
demeure du vieux Laërte.
Cependant
la Renommée, prompte messagère, parcourt la ville en
annonçant la triste fin des prétendants. Les habitants d'Ithaque accourent
de toutes parts, s'assemblent devant le palais d'Ulysse, en poussant
des cris horribles et d'effroyables gémissements. On
enlève les morts restés sous les portiques et on leur donne la sépulture
; les cadavres des prétendants qui étaient venus des îles voisines
sont ramenés dans leur patrie par des pêcheurs qui les emportent
sur leurs rapides navires ; et le peuple, accablé de tristesse,
se rend à la place publique. Quand l'assemblée est formée et
que tous les habitants sont réunis, Eupithée, inconsolable de
la mort de son fils Antinous, qui était tombé le premier sous les
coups du divin Ulysse, se lève et dit en versant des torrents de
larmes :
« O mes amis, cet homme a toujours commis parmi nous d'horribles
forfaits ! Il entraîna jadis sur ses navires de nombreux et vaillants
guerriers, et il perdit à la fois les guerriers et les navires.
Maintenant qu'il est revenu dans sa patrie,
il immole les plus braves des Céphalléniens ! Mes amis, partons avant qu'il se retire à
Pylos ou dans la divine Élide, gouvernée par les Épéens. Marchons,
ou nous serons tous couverts d'un opprobre éternel qui
rejaillira sur nos descendants. Si nous ne punissons pas à l'instant les assassins de nos enfants et de nos frères, la vie n'aura plus
aucun charme pour moi, et j'irai
bientôt rejoindre ceux qui ne
sont plus ! Marchons donc,
afin que nos ennemis ne puissent nous
échapper ! »
En
parlant ainsi, des pleurs s'échappent de ses paupières, et tous
les Achéens sont émus de pitié. — Médon et Phémius, qui viennent
de s'arracher au sommeil, sortent du palais d'Ulysse et
entrent dans l'assemblée : le peuple, en les voyant, est frappé d'étonnement.
Le sage Médon prend la parole et dit :
«
Habitants d'Ithaque, écoutez-moi. Ce n'est point contre la volonté
des dieux qu'Ulysse a immolé les prétendants : j'ai vu moi-même
un des immortels qui, sous les traits de Mentor, était
près du héros. Tantôt cette divinité se tenait devant Ulysse et fortifiait son courage ; tantôt elle se précipitait dans la foule des jeunes
princes, les dispersait dans la salle du festin ; et ils tombaient
tous les uns sur les autres. »
Il
dit,
et les habitants d'Ithaque pâlissent
d'effroi. Le fils de Mastor, Halitherse, vénérable héros,
qui seul connaissait le passé,
le présent et l'avenir,
se lève,
et, plein d'affection pour le
peuple, il s'exprime en ces termes :
«
Habitants d'Ithaque, écoutez ce que je vais vous dire ! C'est à
votre imprudence et à votre timidité seules que vous devez tous
vos maux. Vous n'avez pas voulu suivre mes conseils ni ceux de Mentor, pasteur des peuples, lorsque nous vous conjurions de
réprimer l'insolence de vos fils, de ces insensés qui dévoraient les
richesses d'Ulysse et outrageaient l'épouse de cet homme vaillant
qu'ils croyaient perdu sans retour ! Maintenant obéissez-moi
et suivez enfin mes avis. Ne marchez pas contre Ulysse, si
vous ne voulez point attirer sur vous-mêmes de plus grands malheurs
encore ! »
A
ces mots, plus de la moitié du peuple se retire en poussant de
grands cris ; les autres habitants de la ville demeurent sur la place
sans vouloir suivre les conseils d'Halitherse, et se déclarent pour
Eupithée. Ils se couvrent de leurs armures, et lorsque l'airain
étincelle sur leur poitrine, ils
se rassemblent en foule devant la
spacieuse ville d'Ithaque. Eupithée, qui veut venger le trépas de son fils, se met à leur tête. L'insensé ! il ignore qu'il ne doit plus
revoir ses foyers, et que la mort l'attend
au milieu de ces plaines
!
— La déesse Minerve, s'adressant à Jupiter, fils de Saturne, lui dit :
« O
mon père, toi le plus puissant des dieux, réponds-moi. Quel
dessein caches-tu dans ton âme ? Veux-tu rallumer encore la
guerre cruelle et faire naître de nouveaux combats, ou bien veux-tu cimenter l'alliance entre les deux partis ? »
Jupiter
, le dieu qui rassemble les nuages, lui répond :
« O
ma fille, pourquoi m'interroger ? N'est-ce point par tes propres
conseils que le divin Ulysse, de retour dans sa patrie, s'est
vengé des prétendants ? Agis donc selon ta volonté. Cependant
jeté dirai
ce qu'il me semble le plus convenable de faire. Puisque
le fils de Laërte a puni ces jeunes princes de leur audace, qu'une alliance se forme entre les deux partis, et qu'Ulysse reste roi
d'Ithaque. Nous, bannissons de la mémoire du peuple le meurtre
de ses enfants et de ses frères. Que tous s'aiment,
se chérissent
comme auparavant, et que la paix
et l'abondance règnent
désormais dans cette île. »
Ces
dernières paroles excitent la déesse, qui désire depuis longtemps
mettre fin à tous ces maux ; elle se précipite des sommets de
l'Olympe et descend dans les plaines d'Ithaque.
Lorsque
les convives ont pris leur repas dans la demeure de Laërte,
l'ingénieux Ulysse prend la parole et dit :
«
Que l'un
de nous aille voir si nos ennemis
ne marchent pas contre
nous. »
Un
des fils de Dolius se lève, et du seuil de la porte il voit tout le
peuple qui s'avance. Aussitôt il crie à Ulysse :
«
Nos ennemis approchent; armons-nous promptement. »
A
ces mots tous se lèvent et s'emparent de leurs
armes. Ulysse,
Télémaque , Eumée , Philétius et les six
fils
de Dolius se couvrent
de leurs armures. Laërte
et son serviteur, quoique tous deux
courbés sous le poids des ans et blanchis par
l'âge, sont aussi
forcés de combattre.
Quand l'airain étincelle sur leurs poitrines,
ils sortent
du
palais et s'avancent dans la plaine : Ulysse est à
leur tête.
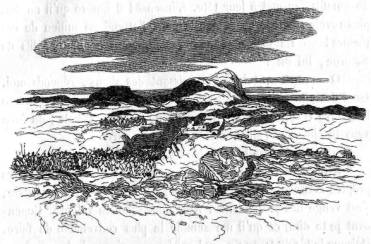
Minerve,
la fille de Jupiter,
se tient près d'eux sous les
traits de Mentor. Ulysse, en
l'apercevant, éprouve une douce joie ; il
dit à son fils chéri :
«
Télémaque, quand tu te trouveras au milieu des combats où se
distinguent toujours les plus vaillants guerriers, j'espère que tu ne
déshonoreras point tes aïeux, qui ont acquis l'admiration des hommes
par leur force et par leur courage. »
Le
prudent Télémaque lui répond aussitôt :
«
Tu verras, ô mon père, si tel est ton désir, que je ne flétrirai point
la gloire de mes ancêtres. »
Le
vieux Laërte, ravi d'entendre de telles paroles sortir de la bouche
de Télémaque, s'écrie :
«
Grands dieux ! quelle joie pour moi ! Que je suis heureux ! Mon fils
et mon petit-fils se disputent le prix de courage ! »
La
divine Minerve s'approche du vieillard
et lui dit
:
«
O fils d'Arcésius,
toi le plus aimé de tous ceux que
je protège,
implore Jupiter et sa fille aux yeux d'azur,
puis agite ton
javelot(14)
et lance-le sur tes ennemis. »
En disant ces mots, Minerve-Pallas donne une force nouvelle au vieux
Laërte, qui implore aussitôt la fille du puissant Jupiter ;
puis il brandit et lance son long javelot qui va frapper Eupithée
le trait impétueux que rien n'arrête traverse avec rapidité le casque d'airain du père d'Antinoüs. Eupithée tombe privé
de la
vie, et le bruit de ses armes
retentit au loin. Ulysse et son illustre fils
se précipitent sur les premiers rangs des ennemis, frappent de
l'épée et de la lance leurs nombreux combattants. Ils vont immoler
tous les habitants venus à leur rencontre et les priver de revoir leur chère cité
; mais Minerve arrête le
peuple en
criant :
«
Ithaciens, cessez de combattre ; épargnez le sang humain et séparez-vous
à l'instant. »
A
ces paroles ils pâlissent tous d'effroi : les armes échappent de
leurs mains tremblantes, et les épées tombent sur le sol. Ils abandonnent
le champ du combat et fuient vers la ville pour sauver
leurs jours. Ulysse, poussant des cris terribles, rassemble ses
forces et fond sur eux comme un aigle au vol rapide qui se précipite
du haut des nues. En ce moment le puissant Jupiter lance
des sommets de l'Olympe sa foudre éclatante qui tombe aux
pieds de sa fille chérie. Minerve dit alors à Ulysse :
«
Noble fils de Laërte, cesse de combattre, si tu ne veux pas que
Jupiter s'irrite contre toi. »
Ulysse,
joyeux, obéit à l'instant. Bientôt la fille du dieu qui tient l'égide,
Minerve-Pallas, sous les traits de Mentor, forme, pour
l'avenir, une alliance sacrée entre le peuple et le roi.
FIN DE
L'ODYSSÉE
Notes, explications et commentaires
(1) L'épithète
Κυλλήνιος,
(vers 1) donnée ici à Mercure
pour la première fois, a fait supposer aux anciens critiques que ce
vingt-quatrième livre n'était point d'Homère. D'autres vont plus
loin encore, car ils font finir le poème de l'Odyssée au vers 296 du
livre précédent. Aristarque, Eustathe et les critiques d'Alexandrie
font remarquer que Mercure n'est jamais considéré dans l'Iliade, et
même dans l’Odyssée, comme une divinité infernale, et n'a jamais la
mission de conduire les âmes ; ils ajoutent qu'Homère ne donne
jamais le nombre des Muses, et qu'il est contre la tradition
homérique d'admettre les âmes dans les enfers avant que les corps
aient reçu la sépulture. Rochefort, qui rapporte ces différents
opinions, pense que le commencement du vingt-quatrième livre de
l’Odyssée a été interpolé ; il dit, en parlant des moyens que
Pénélope emploie pour se soustraire aux poursuites des prétendants
: « Cet épisode offre pour la troisième fois le long récit d'un
artifice fameux de Pénélope ; la première fois que ce, récit paraît
dans l’Odyssée, c'est au chant II, où Antinoüs, s'adressant à
Télémaque, veut rejeter sur Pénélope les désordres qui se commettent
dans le palais, et raconte à ce prince les artifices dont use sa
mère pour retarder ce choix. La seconde fois, ce même récit n'est
pas moins naturel ni moins important que la première. Pénélope
raconte à son époux, qu'elle ne reconnaît pas encore, tout ce
qu'elle a fait pour éviter de se déclarer. Ainsi les convenances
sont parfaitement bien observées, et les lecteurs qui ont lu les
poèmes d'Homère avec quelque attention savent que jamais poète n'a
poussé si loin cet art des convenances. Il n'en faudrait pas
davantage que l'inutilité de ce récit, répété pour la troisième
fois, pour nous persuader qu'une pareille faute ne doit pas être
attribuée à Homère. »
(2) Si nous avions traduit littéralement
ἄμβροτα εἵματα
(vers 59) (vêtements ambrosiens), on ne nous aurait point compris.
Le mot ambrosien n'est usité dans notre langue que dans ces
locutions : chant ambrosien, chant de l'office divin qui est
attribué à saint Ambroise, et messe ambrosienne, messe selon le rit
de l'église de Milan, dont saint Ambroise fut évêque.
(3) Ce passage, que nous avons traduit littéralement, n'a
été ni compris ni rendu par les traducteurs français. Homère dit :
μήτηρ δ᾽ αἰτήσασα θεοὺς περικαλλέ᾽ ἄεθλα
θῆκε μέσωι ἐν ἀγῶνι ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
(vers 85/86)
« Mais la mère ayant obtenu des dieux de très-beaux prix,
les porta dans le milieu de la lice pour les plus braves des
Achéens.
Madame Dacier rend ce passage simple et concis par cette
longue phrase, qui est plutôt une imitation qu'une traduction. « La
déesse demanda aux dieux la permission de faire exécuter des jeux et
des combats par les plus braves de l'armée autour de son superbe
tombeau. »
Bitaubé, qui suit toujours la version de madame Dacier,
dit : « Ta mère, du consentement des immortels, invite les plus
illustres chefs de la Grèce aux superbes jeux dont elle décore une
lice immense. »
Dugas-Montbel se rapproche plus du texte en disant : « Ta
mère, alors, après avoir demandé le consentement des Dieux, dépose
dans la lice des prix magnifiques destinés aux plus illustres des
Grecs. »
Les versions latines ne traduisent pas ces deux vers de la
même manière, quoique pourtant le sens soit le même. Voici la
traduction de Clarke :
Mater autem, diis rogatis, perpulchra certamina
Posuit medio in circo optimatibus Acbivorum.
Dubner, qui a corrigé la traduction du savant anglais, dit
:
Mater autem, rogatis diis, perpulchra certamina
Instituit medio in consessu optimatibus Achivorurn.
Voss a traduit ces deux vers aussi lit éralement que
possible en disant : Aber die Mutter brachf’ auf den Kampfplatz
Vrostliche Preise, von den Gottern erfleht, für die Tapferstein
aller Achaier ( mais la mère apporta sur la lice des prix
précieux demandés aux dieux (qu'elle destinait) pour les plus
braves de tous les Achéens).
(4) Le texte grec porte :
διάκτορος
ἀργεiφόντης
(vers 99) (messager, meurtrier d'Argus, ou messager
Argiphonte). Mercure est ainsi nommé, parce qu'il tua le
surveillant d'Io, cet Argus qui avait des yeux par tout le corps.
Eustathe fait dériver
διάκτορος
de
διάγω ;
Buttmann le tire d'une vieille racine,
διάκω,
διώκω (courir), et le fait synonyme de
διάκονος
; Nitzsch admet l'opinion d'Eustathe, et traduit
διάκτορος par conducteur.
(5) Madame Dacier, Bitaubé et Dugas-Montbel ont commis une
erreur en traduisant
κακός
…. δαίμων (vers 149) par :
dieu jaloux, dieu ennemi, dieu funeste. Clarke et Dubner n'ont
pas été plus exacts en rendant ces deux mots par malus deus.
Le mot
δαίμων
(génie) ne se traduit par dieu ou par déesse, que lorsqu'il se
rapporte à une divinité déjà nommée. Les auteurs du Dictionnaire des
Homérides disent : «δαίμων,
génie, divinité, être de nature divine, qui, selon la
croyance des anciens, agissait dans les occasions qui exigeaient des
facultés on des forces supérieures à celles de l'homme, mais que
cependant on ne pouvait pas appeler un dieu. Homère est également,
étranger à l'idée plus moderne des démons. »
(6) Homère dit :
περὶ
δὲ κλίσιον θέε πάντη
(vers 208), que Dubner traduit
par : circumgue stabulum curreba circumquaque. Les auteurs du
Dictionnaire des Homérides expliquent, ainsi le mot
κλίσιον : « bâtiment de peu de valeur construit tout autour de la
maison du maître, et destiné aux domestiques et aux troupeaux. »
Dugas-Montbel, dans ses Observations, dit : « Le mot
κλίσιον
adonné lieu à beaucoup de conjectures, ce qui prouve que le sens en
est obscur ; les explications qu'on en donne, au lieu de dissiper
l'obscurité ne font que multiplier les doutes. Héliodore entendait
par ce mot une suite de constructions faites amour de l'habitation
principale. Aristarque disait que ce mot signifiait une sorte de
berceau qui régnait autour de la maison, et qui était construit avec
des branches d'arbres. Madame Dacier croit qu'il est ici question
d'un bâtiment circulaire placé au milieu de la cour, et où logeaient
les serviteurs de Laërte : la préposition
περὶ
ne permet pas d'admettre cette explication. D'autres supposent qu'il
est ici question d'une salle où l'on mettait les lits, destinée
aussi à recevoir les instruments de labourage. D'autres supposent
que ce sont simplement les bâtiments pour les troupeaux et les :
valets de ferme. D'autres enfin entendent par là une sorte de
vestibule, de portique, de galerie, dont la maison était entourée ;
ce qui répond parfaitement à l'expression grecque :
περὶ
θέε πάντη.
» Voss dit : Und wirthschaftliche Gebaude liefen rings um den Huf
(des bâtiments domestiques entouraient la cour).
(7) Il est bien ici question de gants, puisque nous lisons
dans le texte grec :
χειρῖδάς
(vers 230). Plusieurs
commentateurs doutent fort que les gants fussent inventés du temps
d'Homère. Ce mot a peut-être été défigure par les rhapsodes ou
interpolé par les grammairiens.
(8) Le texte porte :
ἦ πρῶτ᾽
ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο
(vers 238) : s’il l’interrogerait
d'abord, et réprouverait en chaque chose.
(9) Tous les traducteurs ne rendent pas de la même manière
l'épithète
ἀνθεμόεις
(vers 275).
Madame Dacier traduit
κρητῆρα
πανάργυρον ἀνθεμόεντα
(vers 275) par : « urne d'argent
ciselé où l'ouvrier avait représenté les plus belles fleurs. »
Bitaubé dit : « une coupe d'argent ciselé, » et Dugas-Montbel : «une
coupe d'argent ornée de fleurs sculptées. » L'épithète
ἀνθεμόεις
signifie :
fleuri, émaillé de fleurs, varié, bariolé ; nous pensons donc
que les traducteurs français ont été trop loin en disant que cette
coupe était ciselée.
(10) Ces sortes de couvertures ou de manteaux étaient
nommés
ἁπλοΐς (vers 276) (simples), parce
qu'ils n'enveloppaient le corps qu'une fois.
(11) Ce passage :
ἐμὸν παῖδ᾽,
εἴ ποτ᾽ ἔην γε, δύσμορον,
(vers 289/290) peut aussi être
interprété de celte manière : « Mon fils infortuné, si c'est en effet
lui dont tu parles. »
(12) Homère dit ……ὄρχους
δέ μοι ὧδ᾽ ὀνόμηνας
δώσειν πεντήκοντα, διατρύγιος δὲ ἕκαστος
ἤην· ἔνθα δ᾽ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν,
ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερθεν
Nous avons suivi, pour l'explication de ce passage,
qui n'a jamais été convenablement ni exactement rendu par les
traducteurs français, la traduction qu'en donne le Dictionnaire des
Homérides.
(13) Pour l'explication de ce vers :
ὦ γέρον,
ἤδη οἶδε· τί σε χρὴ ταῦτα πένεσθαι
(vers 407)
nous avons suivi la traduction de Voss ; car on n'aurait
point compris le sens des paroles d'Ulysse si nous avions traduit
littéralement ce que dit Homère.
(14) L'épithète
δολιχόσκιον
(vers 519) (qui projette au loin son
ombre, ou long qu'Homère donne aux javelots et aux lances, n'a été
traduite ni par madame Dacier ni par Bitaubé.
|
|
|
|