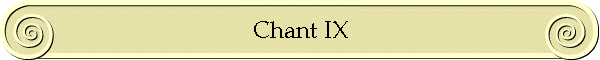« O Roi, qu'on chérit et qu'on révère, dit Ulysse,
quelle fête délicieuse ! Un chantre dont les accents charmeroient
les Dieux mêmes, tout un peuple dans la joie , des convives rangés
autour d'une table où régnent l'abondance et le goût, des cratères
toujours remplis de vin ; des échansons y puisant à pleines coupes !
Je ne sais point de spectacle plus ravissant. » Et, c'est au milieu
d'une telle fête que tu daignes t'occuper d'un malheureux étranger !
tu me demandes pourquoi ces larmes, pourquoi ces sanglots. Hélas !
c'est redoubler mes douleurs et mes peines. Que dirai-je ? Par où
commencer, par où finir ? Les Dieux ont semé de tant de chagrins
tout le cours de ma vie !
» Je te dirai d'abord mon nom. Il faut
que vous le connoissiez. Si j'échappe au malheur qui me poursuit,
j'ose espérer que les liens de l'hospitalité m'uniront à vous.
Malgré la distance qui sépare nos contrées, ces nœuds me seront
chers, et nous les resserrerons encore par des intérêts mutuels.
» Je suis Ulysse, fils de Laërte, qu'une adresse
souvent heureuse et quelques exploits ont fait connoitre dans
l'univers. Ithaque est ma patrie. Là est le mont Nérite, que
couronnent des forêts.
» Autour sont groupées les îles de Dulichium, de Samé,
de Zacynihe. Ithaque, plus humble et plus voisine du continent,
regarde le couchant ; les autres sont situées au levant et au midi.
Le sol d'Ithaque est âpre et hérissé de rochers ; mais il n'est
point de pays plus cher à mon cœur. Calypso, une Déesse, m'a retenu
long-temps dans sa grotte. Circé, une Déesse encore, par des charmes
puissants, a tenté de me fixer dans son palais. Toutes deux m'ont
offert leur main et l'immortalité. J'ai été insensible à leurs vœux
et sourd à leurs promesses. Non, il n'est point de liens plus doux
que ceux qui nous attachent à nos parents, à notre patrie. Loin
d'eux, dans une terre étrangère, il n'est point de sol si fécond,
point d'établissement si riche, qu'il puisse nous consoler de leur
absence.
» Je te dirai mon départ, de Troie et toutes les
traverses que Jupiter a jetées sur mon retour. Des rives d'Ilion le
vent nous poussa sur Ismare, au pays des Ciconiens. Nous saccageâmes
leur ville, nous égorgeâmes ses habitants. Nous enlevâmes et leurs
femmes et leurs trésors, et ce riche butin fut, suivant nos usages,
partagé entre tous mes guerriers. Je voulois fuir de cette contrée ;
mes compagnons indociles dédaignèrent mes conseils et se livrèrent à
tous les excès. Ils se noyèrent dans le vin, ils dévorèrent et bœufs
et moutons.
» Cependant, appelés par les cris des malheureux qui
ont échappé à nos coups, arrivent du continent voisin d'autres
Ciconiens plus nombreux et plus braves, qui savent combattre à
cheval, et, quand il le faut, combattre à pied. Ils viennent au
point du jour nous attaquer jusqu'au milieu de nos vaisseaux. Un
sort funeste nous y attendoit. Là, de pied ferme, la pique à la
main, on combat, on s'égorge ; plus foibles, nous résistons pourtant
; et tout le matin, et la plus grande partie du jour, la victoire
flotte incertaine.
» Mais quand le soleil penche vers son déclin, nous
ployons, et les Ciconiens triomphent. De chacun de nos vaisseaux six
guerriers périssent. Les autres échappent à la mort. Nous nous
rembarquons tristement, pleurant nos compagnons perdus, mais rendant
grâces aux Dieux de nous avoir sauvés du trépas. Avant que de
quitter ce triste rivage, j'appelai trois fois chacun des guerriers
qui étoient tombes sous le fer des Ciconiens.
» Jupiter déchaîne sur mes vaisseaux Borée et les
tempêtes, des nuages épais couvrent la terre et la mer, la nuit
tombe du haut des cieux, nos vaisseaux sont emportés hors de leur
route, le vent déchire nos voiles, nous les ployons, tremblants,
demi-morts de frayeur ; et, à force de rames, nous regagnons la
terre ; épuisés de fatigue, dévorés de chagrins, pendant deux jours,
pendant deux nuits, nous restons étendus sur le sable.
» L'aurore ramène enfin un jour plus serein ; nous
remettons nos vaisseaux à la mer, nous déployons nos voiles, et,
tranquillement assis, nous nous abandonnons à la foi des vents et à
l'art de nos pilotes. J'allois toucher aux rives de ma patrie ;
mais, au moment où je doublois le cap de Malée, Borée, les vagues et
les courants me repoussent et me jettent sur Cythère. Pendant neuf
jours, je fus le jouet des vents et des flots.
» A la dixième aurore, nous abordons au pays des
Lotophages. Les Lotophages se nourrissent du suc des fleurs. Nous
descendons à terre, nous allons à des fontaines voisines puiser de
l'eau pour nos vaisseaux, et mes compagnons prennent leur repas
accoutumé. J'en choisis deux et je les envoie, accompagnés, d'un
héraut, reconnoitre quel peuple habite cette contrée.
» Ils partent, et bientôt ils sont au milieu des
Lotophages. Ils y trouvent un accueil hospitalier ; on leur présente
le lotos ; ils en goûtent, et soudain ils oublient et leurs
compagnons, et mes ordres, et leur patrie. Ils veulent rester avec
les Lotophages, vivre comme eux de lotos, et ne se souviennent plus
de rien de ce qui leur fut cher.
» J'allai les chercher ; je les ramenai pleurants sur
mes vaisseaux ; je les y fis attacher aux bancs des rameurs ; et de
crainte que d'autres encore n'allassent goûter du lotos, et perdre
comme les premiers le souvenir de leur patrie, j'ordonnai qu'on
s'embarquât aussitôt et qu'on mit à la voile.
» Nous partons : la mer blanchit sous nos rames.
Toujours la tristesse dans le cœur, nous arrivons à la vue du pays
des Cyclopes. Les Cyclopes sont des manières de géants, des sauvages
féroces, sans police et sans lois, laissant tout l'aire aux Dieux ;
jamais leurs mains n'ouvrent le sein de la terre, jamais ils n'y
enfoncent le soc de la charrue ; les arbres, les plantes, l'orge, le
blé, croissent pour eux sans semence et sans culture. Pour eux la
vigne se multiplie d'elle-même, et, fécondée par les pluies, elle
donne les plus beaux raisins, les plus riches vendanges et un vin
délicieux.
» Les Cyclopes n'ont ni assemblées, ni conseils, ni
magistrats ; ils habitent clans des antres creux, au sommet des
montagnes. Sans dépendance, sans rapports mutuels, chacun d'eux est
roi dans sa famille.
» Non loin de la terre des Cyclopes, une île se
prolonge toute peuplée de chèvres sauvages. Jamais la présence des
humains n'y trouble leurs retraites ; jamais le chasseur, de ses
courses pénibles, n'y fatigue les montagnes et les bois. On n'y voit
point errer ces animaux que l'homme a soumis à son empire. Nulle
trace de labour ; toujours inculte, toujours inhabitée, celle île ne
nourrit que des chèvres.
» Les Cyclopes n'ont point de vaisseaux ; des mains
industrieuses ne construisent point pour eux ces maisons flottantes
sur lesquelles l'homme défie la mer et les tempêtes, visite les
peuples divers, s'unit à eux par les liens de l'amitié, des intérêts
et des besoins. Ils ne connoissent point ces arts qui fécondent la
terre, et qui l'étoient de ce désert le séjour d'un peuple heureux
et florissant.»
» Le sol n'y est point ingrat. Ils portèrent tout ce
que la nature accorde ailleurs au travail des humains. Au bord delà
mer sont des prairies humides et couvertes de gazons. La vigne
surtout, la vigne y est pleine de sève et de vigueur. La culture y
seroit facile, et un sol naturellement gras et fécond y donneroit
des moissons abondantes. A la tête du port coule une eau limpide,
dont la source est cachée dans une grotte. Autour croissent des
peupliers, qui la couvrent de leur ombre.
» Nous abordons là (un Dieu nous conduisoit sans-doute).
Il faisoit la nuit la plus noire. Point d'étoiles ; un brouillard
épais enveloppoit nos vaisseaux. La lune, cachée dans des nuages, ne
pouvoit nous prêter sa clarté. Aucun de nous n'avoit aperçu cette
île, aucun n'avoit vu les vagues qui, roulant l'une sur l'autre,
alloient expirer sur le rivage, avant que nos vaisseaux eussent
touché la terre. Ils la touchent ; nous ployons nos voiles, nous
nous élançons sur le sable ; et dans les bras du sommeil nous
attendons le retour de l'aurore.
«Dés qu'elle a paru, nous parcourons l'Île, étonnés de
sa solitude. Les chèvres sortent de leurs retraites. Les Nymphes des
montagnes les offraient sans doute à nos besoins. Nous courons
prendre nos arcs et nos javelots, et, divisés en trois bandes, nous
perçons tout ce qui se présente à nos coups. Le ciel nous favorise.
J'avois douze vaisseaux, neuf chèvres furent distribués par chaque
vaisseau ; moi seul j'en eus dix pour mon partage.
» Tout le jour fut pour nous un jour de fête. Nous
avions des vivres en abondance ; du vin, nos amphores étoient
pleines de celui que nous avions pris sur les Ciconiens. Du rivage
où nous étions assis, nos regards se portoient sur la terre des
Cyclopes ; nous voyions la fumée s'élever de leurs antres, nous
entendions le tonnerre de leurs voix, et le bêlement de leurs brebis
et de leurs chèvres.
» Le soleil se couche, les ombres couvrent la terre ;
nous passons encore une nuit étendus sur le sable. Quand l'aurore
eut ramené le jour, j'assemblai mes compagnons : « Restez ici, mes
amis, leur dis-je ; moi, avec mon vaisseau et mon équipage, je vais
visiter celte autre contrée, et reconnoître quels en sont les
habitants, s'ils aiment les étrangers, s'ils respectent les Dieux,
ou s'ils ne sont que des sauvages féroces, sans police et sans lois.
« Nous partons ; l'onde blanchit, sous nos rames, et
bientôt nous touchons au rivage. Non loin de la mer, nous voyons,
sous des rochers menaçants, une caverne immense que couvre une forêt
de lauriers. Une vaste cour est fermée de blocs de pierre, l'un sur
l'autre grossièrement entassés. Autour sont des sapins et des
chênes, dont les cimes se perdent dans les nues. Ça et là errent des
brebis, des moutons et des chèvres.
» Dans cet affreux repaire habitait un énorme géant.
Il alloit seul errant avec ses troupeaux, toujours dans des lieux
écartés, jamais ne conversant avec les autres Cyclopes, jamais ne
s'entretenant que de pensées noires et sinistres. Objet d'étonnement
et d'horreur, qui n'a rien d'humain, et ressemble à ces pics isolés
qui élèvent au-dessus des autres montagnes leur front chargé de
noirs sapins.
» Je laisse mes compagnons à la garde de mon vaisseau.
J'en choisis douze des plus déterminés, et je pars. J'emportais
avec moi une outre pleine d'un vin délicieux que m'avoit donné Maron,
fils d'Évanthée ; Maron étoit prêtre d'Apollon, protecteur d'Ismare.
Il habitait un bois consacré au Dieu dont il étoit le ministre.
J'avais fait respecter son asile, je l’avois garanti, lui, sa femme
et ses enfants, des insultes de mes soldats. Sa reconnoissance me
combla de présents. Il me donna sept talents d'or d'un travail
précieux ; il me donna un cratère d'argent massif ; il me donna
douze amphores d'un vin généreux, un véritable nectar. C'étoit un
trésor caché à toute sa maison ; il n'étoit connu que de lui, de sa
femme, et d'une esclave fidèle, à qui la garde en étoit confiée.
Pour en boire, il falloit mêler vingt coupes d'eau à une coupe de
vin. Dans cet état, il exhaloit encore un parfum digne des Dieux, et
on ne pouvoit se défendre d'y goûter.
« J'en avois fait remplir une outre au large ventre ;
je l'emportai avec d'autres provisions. J'avois un pressen-timent
que nous aurions affaire à un sauvage terrible, inhumain, et je
voulois apprivoiser sa férocité. Nous courons à l'antre, nous n'y
trouvons point le Cyclope. Il étoit dans ses pâturages à garder ses
troupeaux.
» Nous entrons, nous visitons tous les recoins. C'étoit
ici des clayons chargés de fromages ; c'étoit là des tonneaux
remplis de petit-lait, et puis des seaux, des pots, et tout
l'attirail d'une laiterie ; plus loin, dans des parcs séparés, des
agneaux, des chevreaux, chaque âge à part,à part chaque espèce.
» Mes compagnons me conjuraient d'emporter les
fromages, d'emmener agneaux et chevreaux, et de fuir loin de cet
abominable fou. Je ne cédai point à leurs prières ; je voulois voir
le Cyclope ; peut-être j'en obtiendrois les dons de l'hospitalité.
Hélas ! son hospitalité, ce devoit être la mort de mes compagnons !
» Nous allumons du feu, et, tranquillement assis, nous
nous mettons à manger son fromage, en attendant qu'il revienne. Il
revient enfin, apportant une lourde charge de bois sec pour apprêter
son repas. A la porte de son antre, il jette à terre son fardeau
avec un fracas horrible. Nous tremblons de peur, nous courons nous
tapir dans un coin. Il fait entrer chèvres et brebis, tout ce qui
doit lut donner du lait, et laisse hors de sa cour boucs et béliers.
Puis, pour fermer la porte de la caverne, il prend une roche énorme,
que vingt-deux chars à quatre roues n'auroient pas ébranlée ; lui
seul la remue et la place avec autant d'aisance qu'en auroit un
chasseur à fermer son carquois.
» Cela fait, il s'assied, trait ses brebis, trait ses
chèvres, donne à chaque brebis son agneau, son chevreau à chaque
chèvre ; fait cailler la moitié de son lait, et la met dans des
clayons ; l'autre moitié, il la réserve dans des vases, pour la
boire à ses repas.
» Quand il a fini son ouvrage, il allume son feu, et
se met à visiter son antre il nous aperçoit ; et, d'une voix
effroyable : — Qui êtes-vous ? d'où venez-vous sur cette plaine
humide ? êtes-vous des marchands ou des aventuriers ? des pirates
qui courent la mer, exposant leur vie pour faire le malheur des
autres ?
» A son terrible aspect, au tonnerre de sa voix, nos
cœurs se brisent. J'ose pourtant lui répondre : — Nous sommes de
malheureux Grecs, que les vents ont égarés sur le gouffre des mers.
Nous revenions de Troie, impatients de revoir notre patrie ; nous
nous sommes perdus dans des routes inconnues : ainsi l'ont voulu les
décrets de Jupiter. Nous sommes des soldats d'Agamemnon, dont la
gloire est montée jusqu'aux cieux, le vainqueur de tant de peuples,
le destructeur de Troie, de cette cité puissante qui régnoit sur
l'Asie. Nous nous jetons à tes genoux, nous sommes tes suppliants :
crains les Dieux, crains Jupiter hospitalier : il est le Dieu des
suppliants, il protège les étrangers, et venge leurs injures.
» Lui d'un ton féroce : — Tu es un imbécile, ou tu
viens de bien loin ! Tu me dis de craindre Jupiter et de respecter
les Dieux. Les Cyclopes se moquent de ton Jupiter et de tes Dieux
fainéants. Ce ne sera pas leur colère qui me fera t'épargner toi et
les tiens, si je n'en ai pas la fantaisie. Mais où as-tu laissé ton
vaisseau ? ici près, ou à l'autre extrémité de notre rive ?
» Il me tendoit un piège ; j'avois trop d'expérience
pour m'y laisser prendre : je lui échappai par un détour adroit. Le
Dieu des mers, Neptune, lui dis-je, a brisé mon vaisseau, les vents
l'ont jeté contre un promontoire hérissé de rochers, à l'extrémité
de ton pays. Tu vois de malheureux restes échappés au naufrage et à
la mort.
» Le barbare, sans me répondre, se jette sur mes
compagnons, en saisit deux, les enlève, les rejette contre terre
comme deux petits chiens. Leurs crânes sont brisés, les cervelles
coulent, et le sol en est humecté. Il les coupe en morceaux et les
dévore comme eût fait un lion des montagnes : il n'en reste ni
intestins, ni chair, ni ossements.
« A la vue de ces horreurs, gémissants, désespérés,
nous tendons au ciel des mains suppliantes. Le monstre, gorgé de
chair humaine, gorgé de lait, se couche tout de son long dans son
antre, au milieu de ses brebis. Je voulois le tuer ; déjà, je tenois
mon épée à la main, prêt à l'enfoncer dans son cœur ; mais une
réflexion m'arrête.... Cette terrible roche qui ferme notre prison,
nous ne pourrons pas l'enlever, et nous périrons tous. Il fallut,
dans les angoisses du désespoir, attendre le retour de l'aurore.
» Elle paroît enfin. Le Cyclope allume son feu, trait
ses brebis et ses chèvres, et répète tout ce qu'il a fait la veille.
Puis il saisit encore deux de mes compagnons, et les dévore. Après
cet affreux repas, il enlève la roche qui ferme sa caverne, fait
sortie ses chèvres et ses brebis, et remet la roche à sa place.
» Je restai là, furieux, méditant la vengeance, et
implorant le secours de Minerve pour l'obtenir. Il me vient une
idée qui sourit à mon imagination. Dans un des parcs étoit un tronc
d'olivier vert encore, que le Cyclope avoit coupé pour s'en faire un
bâton quand il seroit sec. A sa longueur, à sa grosseur, on l'eût
pris pour un mât d'un de ces lourds vaisseaux qui traversent les
mers, chargés de marchandises.
» J'en coupe à peu près une brasse ; je le donne à mes
compagnons pour le dégrossir. Quand ils ont fini leur ouvrage, moi,
je l'amincis par un bout que je termine en pointe. Je le durcis dans
un feu vif et clair, et je le cache dans le fumier dont le parc
étoit rempli. Je fais tirer mes compagnons au sort pour régler quels
seront ceux qui me seconderont dans mon entreprise. Le sort m'en
donne quatre que j'aurois choisis moi-même.
» Sur le soir, arrivent le géant et ses troupeaux.
Cette fois, soit soupçon, soit inspiration d'un Dieu, il fait tout
entrer dans sa caverne, et chèvres et brebis, et boucs et béliers,
et ne laisse rien dehors. Puis il recommence son train accoutumé,
saisit encore deux de mes compagnons, et fait son horrible repas.
» Je m'approche de lui, un flacon de mon vieux vin à la
main. Tiens, Cyclope ; tiens, lui dis-je, bois-moi ce vin pour
digérer ces chairs que tu as dévorées. Tu verras quelle divine
liqueur renfermoit notre vaisseau. Mon dessein étoit de te l'offrir
si tu avois pitié de moi, si tu pouvois me rendre à ma patrie. Mais
ta fureur ne respecte rien. Barbare ! Eh ! qui oseroit t'approcher
quand tu te livres à de tels excès ?
» Il prend mon flacon et l'avale d'un trait. Ses sens
en sont charmés, il m'en demande un autre. — Donne, dit-il, donne
encore. Dis-moi ton nom ; je veux te faire un présent dont tu seras
satisfait. La terre donne bien aux Cyclopes un vin généreux, les
pluies du ciel nourrissent nos raisins ; mais ta liqueur c'est de
l'ambroisie, c'est du nectar. Il dit ; je remplis le flacon, trois
fois je le remplis, l'insensé le vide trois fois.
» Quand les fumées du vin curent troublé son cerveau,
je lui dis d'un ton mielleux : Cyclope, lu m'as demandé mon nom, je
te le dirai : donne-moi le présent que tu m'as promis. Mon nom est
Personne. Mon père, ma mère, tous ceux qui me connoissent
m'appellent Personne. Le cruel me répond :
— Eh bien, je mangerai Personne le dernier ; oui,
après tous ses compagnons.
« Il dit, et, penché en arrière, il tombe à la renverse.
Sa tête s'incline sur ses épaules, un lourd sommeil oppresse tous
ses sens. Il ronfle, et de son gosier sortent des flots de vin et
des lambeaux de chair encore saignante.
» J'enfonce mon pieu sous la cendre brûlante, j'anime
le courage de mes compagnons. Le bois s'échauffe ; bientôt il est
tout en feu ; je le retire. Mes compagnons sont debout autour de moi
; un Dieu leur inspire une audace nouvelle : ils saisissent le pieu
et l'enfoncent dans l'œil du Cyclope. Moi, dressé sur la pointe des
pieds, j'appuie sur l'autre bout, et nous le faisons tourner. Ainsi
sous la main d'un artisan tourne une tarière qui perce des madriers
destinés à former le flanc d'un vaisseau. D'autres bras secondent
ses efforts et accélèrent le mouvement.
» Ainsi s'enfonçoit notre pieu dans l'œil du Cyclope.
Le sang en jaillit tout brûlant. Son sourcil, sa paupière, sont
enveloppés de la fumée qu'exhalé sa prunelle embrasée. Les racines
de l'œil sifflent sous le feu qui les dévore. Ainsi, quand pour
durcir en acier une hache, une cognée, le forgeron les plonge dans
une eau froide, l'onde crie et jaillit en fumée. Ainsi l'œil du
Cyclope siffle et s'évapore sous le pieu qui le déchire.
» Le monstre pousse des cris terribles. Toute la
caverne, tous les rochers d'alentour en retentissent. De frayeur,
nous nous rejetons en arrière. Lui, de ses mains, arrache le pieu
ensanglanté, le jette loin de lui, et puis il appelle à grands cris
les Cyclopes qui habitent dispersés sur ces hauteurs toujours
battues par les vents.
» Ils accourent à sa voix, et, debout autour de son
antre : — Qu'as-tu, Polyphême ? pourquoi pendant la nuit ces cris
affreux qui troublent notre sommeil ? Sont-ce tes troupeaux qu'on
t'enlève, ou ta vie qu'on menace : — Lui, du fond de sa caverne :
C'est Personne. — Quoi ! Personne ? — Oui, Personne, vous dis-je. —
Eh ! si personne ne t'attaque, que faire ? il n'y a moyen d'éviter
les maux que le ciel nous envoie ; invoque ton père le Dieu des
mers.
« Ils disent, et s'en vont. Moi, je riois dans mon
coin du succès de ma ruse. Le Cyclope gémissant se lève et va en
tâtonnant ôter la roche qui ferme sa caverne, s'assied sur le seuil
de sa porte et tient ses bras étendus pour saisir celui d'entre nous
qui se hasarderait à sortir. Il se flattoit que je serois assez
imbécile pour aller me livrer à sa fureur. Je cherchois dans ma tête
quelque moyen de sauver mes compagnons et moi-même. Je tournois, je
retournois dans tous les sens mon esprit et ma pensée. Enfin, je
crus avoir trouvé un heureux stratagème. Il y avoit là des béliers
grands, forts, bien nourris, bien chargés de laine. Je prends des
baguettes d'osier sur lesquelles avoit dormi le Cyclope, j'en forme
des liens et j'en attache les béliers trois à trois. Celui du milieu
porteroit un de mes compagnons, les deux autres marcheront à ses
côtés.
» ll estoit un bélier, le plus vigoureux, le plus
beau de tous. Je le prends, je m'étends sous son ventre, de mes
mains je l'embrasse et je m'attache à sa toison. Nous attendons le
retour de l'aurore. Elle se lève, et le Cyclope appelle ses
troupeaux aux pâturages. Les brebis, les chèvres béloient et
appeloient en vain la main qui devoit les décharger de leur lait.
Leur maître en pleurant les dressoit, les tâtoit ; l'imbécile ne
s'avisa pas que nous étions cachés sous le ventre des béliers. Le
mien sortit le dernier, ralenti par le fardeau qu'il portait. Le
Cyclope le palpe, le caresse : « Eh ! bélier mon ami, pourquoi le
dernier ? Ce n'est pas ton usage de restera la queue du troupeau. La
tête haute, tu courois le premier au pâturage, au fleuve le premier
: le soir tu revenois le premier à la bergerie, et maintenant te
voilà tout le dernier. Ah ! sans doute lu pleures l'œil de ton
pauvre maître, qu'un scélérat a privé de la vue, après avoir dompté
ses esprits avec son vin empoisonné. Ah ! si tu pouvois parler, si
tu pouvois me dire où ce vaurien est caché pour échapper à ma
fureur, bientôt sa cervelle jailliroit dans mon antre, et je serois
vengé dos maux que m'a faits ce misérable Personne. Il dit, et
laisse sortir le bélier.
» Une fois hors de la caverne, je me détache le
premier, je détache mes compagnons après moi ; nous chassons devant
nous ce qu'il y a de plus beau, de plus gras dans le troupeau du
Cyclope, et par de longs détours nous regagnons notre vaisseau.
« Nous sommes enfin rendus à nos compagnons ; ils nous
serrent dans leurs bras, ils pleurent ceux que nous avons perdus.
Moi, par des signes, je leur défends les cris, je leur ordonne
d'embarquer les moutons, les béliers et de hâter notre départ. Ils
obéissent, et bientôt, la rame à la main, ils frappent à coups
redoublés les ondes écumantes.
» Arrivés à une distance d'où ma voix peut encore se
faire entendre, j'exhale en ces mots ma fureur et ma rage :
Détestable Cyclope, ces malheureux que tu as dévorés dans ta
caverne, tu sens maintenant qu'ils n'appartenoient pas à un lâche, à
un mortel impuissant ! enfin, tes crimes sont retombés sur ta tête.
Misérable, tu n'as pas craint d'immoler dans tes foyers des
suppliants qui t'imploroient ; aussi Jupiter et les Dieux ont puni
tes forfaits.
» A ces mots, le monstre furieux saisit un quartier du
rocher qui couvre le sommet de sa montagne, et le lance à l'avant de
mon vaisseau. Sous cette masse pesante l'onde se soulève et bondit,
les flots reculent et nous reportent au rivage. Je prends une longue
perche, et, l'appuyant contre terre, je repousse le vaisseau en
pleine mer, et du geste et de la voix j'exhorte mes compagnons à
redoubler d'efforts pour nous arracher à de nouveaux malheurs. Ils
se courbent, sur leurs rames, et bientôt nous avons parcouru un
intervalle double de celui que nous avions mesuré la première fois.
» Je veux, par de nouveaux cris, insulter au Cyclope ;
mes compagnons, par de douces instances, s'efforcent de m'arrêter :
—O prince infortuné ! pourquoi irriter encore ce monstre sauvage ?
Tout à l'heure, la roche qu'il nous a lancée nous a repoussés sur la
côte; nous avons cru que nous étions perdus : s'il entend ta voix,
si tes cris vont jusqu'à lui, d'un coup plus terrible il brisera
notre vaisseau et nous abîmera dans les flots.
» Je demeurai inflexible et recommençai avec plus de
fureur. — Exécrable Cyclope ! si on te demande qui t’a privé de la
vue, dis que c'est Ulysse, le fils de Laërte, le destructeur des
cités, le souverain d'Ithaque ! — » La voilà donc, s'écrie
Polyphême, la voilà donc accomplie, et accomplie sur moi, cette
vieille prédiction de Télémus, le fils d'Eurymis, ce devin fameux
qui fatigua si longtemps les Cyclopes de ses oracles ; il annonça
ce que j'éprouve aujourd'hui : qu'un Cyclope perdrait la vue de la
main d'Ulysse.
» J'attendois un mortel grand, vigoureux, et c'est un
avorton, un misérable sans force et sans courage, qui, après m'avoir
empoisonné avec son vin, m'a réduit à ce triste état. Viens, Ulysse
; viens que je te paie comme tu le mérites ; viens que je te
recommande au Dieu des mers, que je le conjure de protéger ton
retour. Je suis son fils ; il se fait gloire d'être mon père. Il
saura me guérir : c'est à lui seul que je dois m'adresser.
— » Va, lui répondis-je, ton père ne te rendra pas
l'œil que tu as perdu. Que ne suis-je aussi sûr de t'arracher la vie
et de te précipiter au séjour des enfers !
Lui, tendant les mains vers le ciel, il invoquoit
Neptune: — Écoute-moi, disoit-il, ô toi qui de ton trident fais
trembler la terre ! si je suis ton fils, si tu t'honores d'être mon
père, fais que cet Ulysse, ce fils de Laërte, ce souverain
d'Ithaque, ne rentre jamais dans ses foyers. Si son destin est de
revoir ses amis, sa patrie, fais du moins, fais qu'il y rentre tard,
qu'il y rentre malheureux, sur un vaisseau étranger, après avoir
perdu tous ses compagnons, et qu'il ne trouve que désastres dans sa
famille. Neptune n'entendit que trop sa prière.
» Il saisit ensuite une roche énorme, la balance en
l'air, lui imprime une force irrésistible, et la lance. Elle tourne,
frappe à l'arrière de mon vaisseau : peu s'en faut que le gouvernail
ne soit brisé ; l'onde déplacée s'élève, pèse sur le vaisseau, et le
pousse au rivage que nous voulions atteindre.
» Là, nous retrouvons et ma flotte et nos compagnons.
Ils étoient errants aux bords de la mer, et leurs regards inquiets
nous cherchoient sur les flots. Nous descendons à terre, nous
débarquons les brebis et les chèvres que nous avons prises sur le
Cyclope, et nous en faisons le partage. Mon bélier me reste ; je
l'immole au Dieu qui règne sur les nuages et féconde la terre ; les
cuisses fument sur son autel ; mais il détourne ses regards de mon
sacrifice. Ses décrets ont arrêté la perte de mes vaisseaux et la
mort de mes compagnons.
» Cependant, tristement assis sur le rivage, nous
mangeons, nous buvons en silence ; puis nous déplorons le sort des
guerriers que le Cyclope nous a ravis. Enfin, le soleil se plonge
dans les eaux, et la nuit nous couvre de ses ombres. Étendus sur la
terre, nous oublions dans les bras du Sommeil nos fatigues et, nos
peines. Dès que l'aurore se lève, j'ordonne les apprêts du départ :
soudain les voiles se déploient, l'oncle écume et mugit sous nos
rames, st nous laissons derrière nous cette terre abhorrée, en
rendant grâce aux Dieux qui nous ont sauvés. »