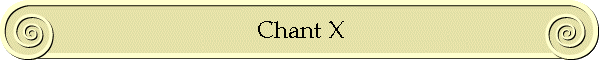AVENTURES D'ULYSSE
CHEZ ÉOLE, CHEZ LES LESTRYGONS ET CHEZ CIRCÉ.
Nous gagnons
l'île où reste Éole, île flottante
Ceinte d'un mur
d'airain et de roche éclatante ;
Là le fils d'Hippotas,
Éole cher aux dieux,
A douze enfants, six
fils, six filles, qu'en ces lieux
Ensemble il maria
florissants de jeunesse ;
Près des chers père
et mère ils festinent sans cesse,
De nombreux mets
servis fument dans ce séjour
Qui retentit de sons
de flûtes dans le jour,
Eux la nuit
s'endormant près d'épouses chéries
Sur de beaux lits
sculptés et des tapisseries.
Nous fûmes à la
ville, aux palais somptueux
D'Éole un mois
entier notre hôte affectueux,
M'interrogeant sur
tout, sur la flotte argienne,
Le retour des Grecs,
Troie, et du mieux qui convienne,
Je lui raconte tout
puis demande à partir ;
Il tient mon retour
prêt, veut bien y consentir,
M'offre une outre de
bœuf de neuf ans, lie, en outre,
Les divers vents
fougueux enfermés dans cette outre,
Jupiter l'ayant fait
dispensateur du vent
Qu'il calme ou qu'il
soulève ainsi qu'il veut souvent ;
Il prend un beau
lien, fixe l’outre au navire
Pour que nul vent ne
souffle autre que le zéphire ;
Ce fut en vain : les
miens, imprudents ! ont péri !
Nous naviguons neuf
jours et nuits ; mon sol chéri,
Le dixième, déjà
tout près peut m'apparaître,
Ceux allumant du feu
près de nous semblent être,
Mais là le doux
sommeil me saisit épuisé,
N'ayant jamais aux
mains de l'un des miens posé
La barre du vaisseau
toujours par moi tenue,
Vers le sol paternel
hâtant notre venue ;
Mes compagnons entre
eux causent en se disant
Qu'à la maison
j'emmène or, argent, maint présent
Que le fils d'Hippotas
Éole aime à me faire ;
Regardant son
voisin, chacun d'eux en confère :
« Qu'il est
aimé, prisé cet Ulysse, ô grands dieux !
Par tous quand il
arrive en leur ville, en tous lieux !
Il emporte de Troie
un trésor innombrable,
Mais nous, tout en
suivant une route semblable,
Nous rentrons, la
main vide ; Éole, encore ici,
Le prend en amitié,
lui fait ces présents-ci ;
Mais vite examinons
quels sont ces dons, en outre,
Combien d'or et
d'argent se trouve dans cette outre ? »
Ils disent, et
prévaut ce désastreux projet ;
Ils ont délié
l'outre, et tous les vents d'un jet
S'élancent, et
soudain la tempête en furie
Les pousse en pleurs
au large et loin de la patrie ;
Je m'éveille, et
j'hésite en mon grand cœur s'il faut
Périr, de mon navire
en mer plonger d'un saut,
Ou parmi les vivants
souffrir, me taire, attendre ?
Je restai,
j'endurai, me voilai, fus m'étendre
Au fond de mon
vaisseau, mes compagnons en pleurs,
De nouveau remportés
par ces vents de douleurs
Jusqu'à l'île
d'Éole, où l'on descend à terre,
De l'eau puisée, on
mange et l'on se désaltère
Près de nos prompts
vaisseaux, d'où moi-même je prends
Un des miens et
m'adjoins un héraut puis me rends
Aux beaux palais
d'Éole en ce moment à table ;
Sa femme et ses
enfants en festin délectable
Se trouvent réunis
et surpris de nous voir,
Sur le seuil de la
porte ils veulent tout savoir :
« Comment !
Ulysse, ici toi tu te représentes !
Quelle divinité
parmi les malfaisantes
A donc fondu sur
toi, nous avec tant de soins
T'ayant congédié,
prévoyant tes besoins,
Afin que ton retour
doive aisément se faire
Dans ta patrie,
ailleurs si ton cœur le préfère ? »
Ils ont dit ;
l'âme en peine ainsi je parle entre eux :
« De méchants
compagnons, un sommeil malheureux
M'ont nui ;
m'accorder aide, amis, vous est possible. »
Je dis pour les
toucher, mais chacun impassible,
Le père me répond
dans les termes suivants :
« Va-t'en de
l'île, ô toi le plus vil des vivants !
Il n'est juste, en
effet, de soigner, reconduire
Un homme en haine
aux dieux, qui vient là se produire
Haï des immortels,
va-t'en donc sans délais. »
Il dit, dans mes
sanglots me chasse du palais.
De là partis
chagrins, tous en fatigue immense,
Sans espoir de
retour et par notre démence,
Pendant six jours et
nuits ainsi nous naviguons,
Arrivons, le
septième, au sol des Lestrygons,
Aux grands murs de
Lamus, Télépyle où sans cesse
Un berger qui
revient appelle, pour qu'il paisse,
Un berger qui
l'écoute et mène ses troupeaux ;
L'homme y gagnerait
double en perdant tout repos,
Menant d'abord des
bœufs puis de blancs moutons paître,
Car dans leur cours
le jour à la nuit s'enchevêtre.
Entrés dans un beau
port qu'entouré un haut rocher,
Dans toute la
longueur on y voit s'approcher
Les rivages
saillants se faisant face ensemble ;
L'entrée en est
étroite, au dedans on rassemble
Nos vaisseaux
ballottés qu'on lie au fond du port
Où ni grand ni
petit, le flot n'est jamais fort ;
Un blanc calme
l'entoure ; or seul je n'en approche,
Tiens dehors mon
vaisseau que j'attache à la roche ;
Puis je monte en
haut lieu d'où l'on n'apercevait
Nul travail de
bœufs, d'homme, et seule s'élevait
De terre une fumée
où j'envoyai se rendre
En avant deux des
miens choisis pour nous apprendre
Quels sont les
habitants du sol ; nous adjoignons
Un héraut en
troisième à nos deux compagnons.
Suivant un
chemin plat par où tous les chars prennent
Pour porter des
hauts monts le bois qu'en ville ils traînent,
Ils trouvent une
vierge aux puits près du rempart ;
Fille du Lestrygon
Antiphate, elle part
Vers la source
Artacie à la belle eau qui brille,
Qu'on puise pour la
ville ; on demande à la fille
Quels sont le roi,
son peuple ? elle désigne où sont
Les hauts toits
paternels ; la reine, comme un mont,
Paraît sur leur
chemin et les effraye ; en hâte,
Sur la place
publique, elle appelle Antiphate,
Son noble époux qui
leur fait un cruel trépas,
Saisissant l'un des
miens, il en fait son repas ;
Les deux autres en
fuite aux vaisseaux vont se rendre ;
Par la ville
Antiphate a crié de nous prendre ;
Les vaillants
Lestrygons courent épars, nombreux,
Semblant, non des
mortels, mais des géants affreux,
Lançant des
cailloux, rocs les plus lourds pour des hommes ;
Un bruit funeste
monte aux vaisseaux où nous sommes,
Bruit de vaisseaux
brisés, de nous qui périssons,
Que pour d'affreux
repas, ainsi que des poissons,
Ils emportent
percés, dans leurs profondes rades ;
Les Lestrygons tuant
ainsi mes camarades,
J'extrais mon glaive
aigu, coupe le câble et dis
Aux miens de ramer
fort, tous je les enhardis
Pour fuir un sort
fatal et tous font jaillir l'onde,
Craignant la mort ;
les rocs faits en voûte profonde
Évités, vers la mer
mon navire à l'abri
Fuit, les autres là
même en foule ayant péri.
Nous voguons au
delà, contents de notre fuite,
Navrés pour nos amis
qui sont morts ; nous de suite
Gagnons l'île d'Éa
de la belle Circé,
Sœur du sage Eétès ;
leur mère était Perse,
Fille de l'Océan, et
le Soleil leur père,
Le flambeau des
mortels ; notre navire opère
L'atterrage sans
bruit où nous dirige un dieu,
Bon port où harassés
notre séjour a lieu,
L'âme en proie au
chagrin, deux jours et nuits encore ;
Mais le troisième
jour que luit la belle Aurore,
Je prends mon
piquant glaive et ma lance à la main,
Je quitte mon
vaisseau, je me mets en chemin
Vers un haut point
de vue et j'essaye, où nous sommes,
D'entendre quelques
voix, de voir des travaux d'hommes ;
Je m'arrête en haut
lieu, d'un sol vaste apparaît
Une fumée allant
d'une épaisse forêt
De chênes où Circé
demeure, et là j'hésite
Dans l'esprit et le
cœur à lui faire visite,
A m'informer où j'ai
vu la fumée en l'air ;
Je pense que le
mieux est que j'aille à la mer,
D'abord au prompt
navire afin d'y faire prendre
A mon monde un
repas, puis d'envoyer apprendre.
Vers mon navire à flots je m'avance en ces lieux,
Je m'achemine seul,
quand soudain un des dieux
M'ayant pris en
pitié, dans sa bonté m'envoie
Un cerf à haute
corne, au milieu de ma voie ;
Du pâturage au bois
par un soleil ardent,
Il descend boire au
fleuve et moi sur lui dardant,
Mon airain à
l'échiné en plein dos le traverse ;
Sans souffle dans le
sable il tombe à la renverse ;
Monté sur lui,
j'extrais mon javelot d'airain,
Et plaçant l'animal
couché sur le terrain,
De broussaille et
d'osier que j'arrache, je tresse
Une corde en deux
sens tressée avec adresse,
D'une brasse de
long, et du gros animal
J'en attache les
pieds ; j'eusse eu beaucoup de mal,
Tant ce cerf était
gros, si j'eusse dû le prendre
D'une main ; je le
mets sur mon dos, vais me rendre,
Appuyé sur ma lance,
au navire où je mis
La bête sur le sol
et dis à mes amis :
« Amis, bien
qu'affligés, nous ne devons, du reste,
Descendre chez
Pluton avant le jour funeste ;
Tant qu'à boire et
manger sera pour nous à bord,
Nous ne mourrons de
faim et là mangeons d'abord. »
Ces mots vite
obéis, tous apparus se mirent
Près des stériles
flots des mers où tous admirent
Le volumineux cerf,
et lorsque dans ces lieux
Tous ont été charmés
en contemplant des yeux,
Ils se lavent les
mains, un beau repas s'apprête,
Jusqu'au soleil
couchant notre festin n'arrête,
Et nous restons à
table à nous régaler tous
Et d'abondantes
chairs et de vin pur et doux.
Mais le soleil
couché, dès que la nuit arrive,
Tous au bord de la
mer nous dormons sur la rive.
La fille du Matin,
l'Aurore aux doigts rosés
Paraît, je dis aux
miens en Conseil tous posés :
« Amis, chers
compagnons, tous, bien qu'en peine extrême,
Écoutez mon avis :
Sans que nous sachions même
Où l'Aurore paraît,
non plus par quels chemins
Nous revient le
Soleil, le flambeau des humains,
Où sous terre il
s'en va, décidons quelle voie
Peut encore être
prise, (et je crains qu'on n'en voie);
Monté sur un haut
lieu, j'ai pu voir un îlot
Dans une mer sans
borne entouré par le flot ;
La terre est basse,
au centre une fumée arrive
A travers d'épais
bois de chênes sur la rive. »
Je dis ; leur
cœur se brise, ils songent aux forfaits
De l'affreux
Lestrygon Antiphate, à ceux faits
Par le cruel Cyclope
Anthropophage ; en larmes
Tous fondent, mais à
rien ne servent leurs alarmes.
Mes brillants
compagnons mis en groupes, en deux
Chacun ayant son
chef, je commande l'un d'eux,
Euryloque prend
l'autre, en un casque on balance
Nos deux sorts dont
celui d'Euryloque s'élance.
Il part avec
vingt-deux compagnons tous en pleurs,
Et nous laisse en
sanglots derrière eux, puis les leurs
Trouvent dans un
vallon, bien en vue établie,
La maison de Circé,
tout en pierre polie ;
Des lions et des
loups des montagnes, posés
Autour de la déesse,
étaient apprivoisés
Lorsqu'elle leur
donnait de funestes breuvages,
Ils n'attaquaient
plus l'homme et n'étaient plus sauvages,
Se dressaient, de
leur queue immense caressant ;
Et tels qu'aussi des
chiens agitent, la dressant,
Leur queue autour du
maître alors qu'il sort de table,
Car toujours il leur
porte un morceau délectable,
Tels ces lions, ces
loups aux ongles vigoureux,
Autour d'eux
remuaient la queue, et tout peureux
De ces forts
animaux, mes compagnons attendent
Au seuil de la
déesse aux beaux cheveux, entendent.
Dans ses palais
Circé qui chante à belle voix
Et parcourt une
toile immense sous ses doigts,
Belle œuvre
ambroisiaque, œuvre d'une déesse.
Chef d'hommes,
Politès aux siens ainsi s'adresse,
Il est mon compagnon
le plus cher, respecté :
« Amis, (résonne
un chant), femme ou divinité,
Quelqu'un tisse un
grand voile et chante, crions vite. »
Il dit, et tous
criant, Circé sort, les invite,
Les appelant,
soudain leur ouvre le beau seuil ;
Tous suivent,
imprudents, Euryloque, lui seul
Demeure derrière
eux, soupçonne quelques pièges ;
Circé les mène,
offrant des pliants et des sièges,
Mêle en vin de
Pramné farine, crème et miel,
Et poison pour
l'oubli de leur sol paternel ;
Ils boivent ce
breuvage, et d'un coup de baguette
Circé les frappe
tous, puis les enferme et jette
Dans une étable à
porcs où tous mis en monceaux,
Ont corps et soie et
voix et hures de pourceaux ;
Mais eu eux, comme
avant, l'intelligence est bonne ;
Ils pleurent
renfermés et Circé là leur donne,
Faines, cornouilles,
glands, mets de porcs se vautrant.
Euryloque au
vaisseau revient dire en pleurant
L'amer destin des
siens, l'âme en proie aux alarmes,
Quoiqu'il veuille,
il ne peut parler, et tout en larmes,
Il sanglote, on le
fixe et nous nous renseignons,
Il raconte le sort
fait à ses compagnons :
« Noble Ulysse,
à ton ordre, ayant pris une allée
Par les bois, nous
trouvons au fond d'une vallée
Des palais tout en
marbre, où chanté à belle voix
Quelqu'un, femme ou
déesse, et tissant sous ses doigts
Une très-grande
toile ; or les miens à sa porte
Criant et
l'appelant, elle au dehors se porte,
Leur ouvre, et hors
moi, tous entrés ont disparu ;
Je les attends
longtemps, mais nul n'a reparu. »
Il dit ; d'un
glaive à clous d'argent je m'arme vite,
Je prends en outre
un arc, et soudain je l'invite
A me conduire allant
par les mêmes chemins ;
Mais il m'implore, a
pris mes genoux de ses mains :
« Héros, là
laisse-moi, ne me force à m'y rendre,
Tu n'en reviendras
pas ni ne pourras reprendre,
Je le crois, nul des
tiens, fuyons de ce séjour,
Si nous pouvons
encor fuir le funeste jour ! »
Il a dit ; je
m'empresse à mon tour de lui dire :
« Euryloque, ici
reste et bois, mange au navire,
J'irai, c'est pour
moi-même un besoin des plus grands. »
Je dis et du
vaisseau, de la mer je me rends
Par les sacrés
vallons aux palais magnifiques
De Circé préparant
des philtres maléfiques ;
Mercure à rameau
d'or vers moi vient en chemin,
Semble un jeune
homme imberbe, et dit, prenant ma main :
« Où vas-tu par
ces monts, malheureux, solitaire,
Où vas-tu sans avoir
su quelle est cette terre ?
Et tels que des
pourceaux chez Circé sont les tiens
Tous gardés à
l'étable, est-ce qu'ici tu viens
Voulant les délivrer
? Pour ton retour redoute,
Avec tes compagnons
tu resteras sans doute.
Mais voyons, moi je
veux du mal te préserver :
Prends l'herbe
salutaire et qui peut bien sauver
Du fatal jour ta
tête, oui, prends-la pour te rendre
Aux palais de Circé
dont là je veux t'apprendre
Les perfides
desseins : Elle t'apprêtera
Dans un mets des
poisons, mais en vain tentera
Ton ensorcellement,
la plante salutaire
Devant lui faire
obstacle, et je vais ne rien taire :
Dès que Circé t'aura
touché dans son palais
De sa longue
baguette, alors fonds sans délais,
D'à côté de ta
cuisse ayant dégainé, lève,
Comme voulant la
mettre à mort, ton piquant glaive ;
Elle t'invitera, par
crainte, à reposer
Sur sa couche
divine, et ne va refuser,
Afin qu'elle délivre
et les tiens et toi-même,
Qu'elle te soigne
bien, jure un serment suprême,
Serment des dieux
heureux, de n'ourdir contre toi
Nul piège qui
t'énerve en lâche sous sa loi. »
Le dieu m'offre,
ayant dit, la plante que de terre
Il tire, en m'en
montrant le propre caractère :
Racine noire et
fleur blanc-lait, qu'avec efforts
Déracine un mortel,
les dieux, en tout plus forts,
L'appellent tous
Moly ; Mercure ensuite passe
Par les bois pour
gagner l'olympien espace ;
Moi je vais chez
Circé déesse aux beaux cheveux,
J'agite en mon
chemin mille pensers et vœux ;
Je crie en
m'arrêtant vers le seuil de la porte
La déesse, à ma
voix, vite au dehors se porte,
Ouvre le brillant
seuil, je la suis, m'affligeant ;
Elle m'introduit,
m'offre un siège à clous d'argent,
Chef-d'œuvre où pour
les pieds est mise une escabelle ;
Elle emplit d'un
mélange une coupe en or, belle,
Y jette un philtre à
boire, et perfide en son cœur,
Elle m'offre la
coupe où je bois la liqueur,
Mais ne
m'ensorcelant ; sa baguette me touche,
En même temps ces
mots s'échappent de sa bouche :
« A ton tour
maintenant, toi-même aussi va, tiens,
Vas à l'étable à
porcs coucher avec les tiens. »
Elle a dit ;
tout à coup tirant mon piquant glaive
D'à côté de ma
cuisse, en courant je le lève
Et fonds contre
Circé, comme voulant sa mort ;
Mais à moi la déesse
accourt en criant fort,
Me saisit les genoux
et toute désolée,
Versant des pleurs,
me dit cette parole ailée :
« D'où, quel
es-tu, les tiens, ton pays, dis ? Comment !
Sans que tu sois
charmé, que j'ai d'étonnement !
Toi tu bus ces
boissons qu'un autre ne supporte
Dès qu'il les boit,
des dents leur fait franchir la porte !
Quelque esprit
qu'on ne peut charmer sans doute est-il
Dans ta poitrine ?
Es-tu cet Ulysse subtil
Que le vainqueur
d'Argus à rameau d'or sans cesse
M'annonçait revenant
de Troie en navire ? Est-ce
Toi-même ? Eh bien,
remets ton glaive au fourreau, toi,
Puis sur ma couche
monte, en mutuelle foi
Par la couche et
l'amour unissons-nous ensemble. »
Elle dit ; je
réponds ainsi ce qu'il m'en semble :
« Circé, comment
peux-tu toi-même m'engager
A rester doux pour
toi, quand tu viens de changer
Mes compagnons en
porcs dans ton palais, par ruses
Voulant m'y retenir
afin que tu m'abuses,
M'invitant à monter
sur ta couche en ces lieux,
A me rendre à ton
lit, pour que dépouillé mieux,
Tu me fasses un
lâche, ainsi que tu concertes ?
Mais je ne monterai
sur ta couche, non certes,
Que d'abord ne me
soit fait par toi le serment
Que tu ne m'ourdiras
quelque autre détriment. »
C'est ainsi que
je parle, et la déesse vite
Par serment jure
non, ainsi que je l'invite.
Après que son
serment se trouve prononcé,
Je monte sur le lit
superbe de Circé.
Quatre servantes
sont dans le palais près d'elle,
Chacune a son office
et s'y montre fidèle ;
Filles des Fleuves
saints qui coulent dans les mers,
Des sources et des
bois, l'une tient recouverts
Les sièges sous le
lin et des toiles vermeilles ;
L'autre aux tables
d'argent met de riches corbeilles ;
La troisième mélange
en un cratère encor
En argent, du doux
vin qu'elle offre en coupes d'or ;
La quatrième apporte
une eau chaude qui fume
Dans un vaste
trépied sur un feu qu'elle allume ;
L'eau chaude, elle
me mit au bain et m'y lava
La tête et les bras
d'eau douce qui m'enleva
La fatigue rongeant
au cœur et qui harasse ;
Après le bain dans
l'onde, elle m'oint d'huile grasse,
Me revêt d'un beau
linge et d'un manteau, m'assied
Sur un siège
superbe, une escabelle au pied ;
Sur un bassin
d'argent, à son tour une esclave
Met une belle
aiguière en or où je me lave
Dans l'eau
d'ablution ; une table de prix
Par l'honnête
intendante est mise, elle ayant pris
Du pain, des mets
nombreux qu'elle me sert à table ;
Circé m'invite à
prendre un repas délectable ;
Mais prévoyant des
maux, mon cœur ne s'y plaît pas,
Et là je reste assis
sans songer au repas.
Aussitôt que
Circé s'aperçoit que j'endure,
Sans prendre
d'aliments, une peine aussi dure,
Elle vient près de
moi pour me dire ces mots :
« Ulysse,
pourquoi donc rongeant ton cœur de maux,
Es-tu comme muet,
sans que là toi-même uses
De mets ni de
boissons, craindrais-tu d'autres ruses ?
Cependant tu ne dois
craindre aucun détriment,
Moi t'en ayant déjà
fait un très-grand serment. »
Elle dit; je
réponds à la déesse auguste :
« 0 Circé,
pourrait-il être un seul homme juste
Qui sans revoir les
siens, avant de les avoir
Fait mettre en
liberté, consente à recevoir
Des mets et des
boissons ? Délivre-les donc vite
Si ton cœur par
bonté dans ce moment m'invite
A me nourrir, à
boire, afin que sous mes yeux
Tous mes chers
compagnons paraissent en ces lieux. »
Ainsi je dis ;
Circé hors du palais se porte,
Et sa baguette en
main, ouvre soudain la porte
De l'étable à
pourceaux, d'où s'élancent dehors
Mes compagnons qui
tous ressemblent à des porcs
Déjà vieux, de neuf
ans, et tous mis devant elle
Qui passe entre eux,
applique à tous sa drogue telle
Que tout à coup les
poils dont ils sont recouverts,
Qu'a fait pousser
déjà le breuvage pervers
De l'auguste Circé
sur leurs membres, n'y tiennent,
Ils en tombent et là
mes compagnons deviennent
De plus jeunes, plus
grands, plus superbes humains
Qui m'ayant reconnu,
tous me prennent les mains ;
Tous versent de doux
pleurs dont la demeure entière
Retentit, et Circé
déesse auguste, altière,
Elle-même est émue
et m'aborde en disant :
«
Sage Ulysse, grand fils de Laërte, à présent
Vas à ton prompt
vaisseau, vous sur la terre ferme
Tirez-le, déposez
dans un antre qui ferme,
Les agrès et vos
biens ; puis toi reviens vers moi,
Tous tes chers
compagnons amenés avec toi. »
Elle a dit,
convaincu mon grand cœur, et vers l'onde
Et mon vaisseau je
pars, j'y trouve tout le monde
A gémir dans des
pleurs abondants et touchants ;
Ainsi, quand des
troupeaux sont parqués dans les champs,
Les génisses s'en
vont bondir à la rencontre
Des mères dont la
troupe à son retour se montre,
Gagne l'étable où
vient tout leur troupeau repu,
Rassasié d'herbage,
et leur enclos rompu,
Rien ne les
arrêtant, ces génisses accourent
Près des mères
qu'alors en foule elles entourent
Toutes en mugissant
; ainsi mes compagnons,
Dès qu'ils m'ont
aperçu, que nous nous rejoignons,
Là fondent tous en
pleurs, et dans l'âme il leur semble
Se trouver revenus
dans leur patrie ensemble,
Être dans l'âpre
Ithaque, en leurs murs ramenés
Où tous furent
nourris et tous même étaient nés ;
Ils me disent
soudain, tous gémissants en larmes :
« 0 fils de
Jupiter, revenu tu nous charmes
Comme si nous étions
nous-mêmes de retour
Sur la terre patrie,
en Ithaque ; à leur tour,
Des autres
compagnons dis la perte, raconte. »
Ils disent ;
doucement je leur en rends bien compte :
« Sur la rive
tirons le vaisseau, mes amis,
Et nos biens, nos
agrès tous dans des grottes mis,
Ensemble venez tous,
hâtez-vous de me suivre,
Pour voir nos
compagnons manger, boire et bien vivre
Tous sans cesse aux
palais de l'illustre Cirée. »
Je dis, on se
conforme à l'ordre prononcé,
Mais Euryloque seul
les arrête, il s'écrie :
« 0 malheureux,
où donc allons-nous, je vous prie ?
Chez Circé qui de
nous va faire sans délais
Des lions, loups ou
porcs gardant ses grands palais !
Comme Cyclope fit
quand Ulysse indomptable
Avec nos compagnons
entra dans son étable ;
Eux par son
imprudence ont péri, je le dis ! »
Dégainant mon
long glaive, à ce discours j'ourdis
De lui trancher la
tête et bien que parent proche,
J'allais l'abattre
au sol, mais là chacun m'approche,
Me retient par un
mot doucement prononcé :
« Laisse-le,
divin chef, conduis-nous chez Circé.
Ayant dit de la
sorte, ils montent de la rive
Et quittent le
vaisseau, même Euryloque arrive,
Il n'y reste pas
seul, pénétré de terreur
A ma menace faite
avec tant de fureur.
Pendant ce temps
Circé dans sa demeure baigne
Nos autres
compagnons et d'huile les imprègne,
Les couvre de
manteaux de tuniques, et nous
Les trouvons au
palais à festiner bien tous.
Quand tous se sont
revus, en pleurs on s'examine,
Le palais en résonne
et Circé s'achemine
Au milieu de nous
tous en m'adressant ces mots :
« Adroit fils de
Laërte, aussi je sais vos maux
Sur la mer
poissonneuse, et combien même, Ulysse,
Sur terre l'ennemi
vous causa de supplice ;
Cessez vos pleurs,
mangez, buvez, et qu'en effet
Vous repreniez un
cœur tel qu'il fut d'abord fait
Quand vous de l'âpre
Ithaque avez quitté la terre.
Le souvenir des maux
de vos courses altère
Vos forces, votre
esprit à jamais malheureux
Parce que vous avez
souffert des maux nombreux. »
Elle dit, de
nouveau convainc nos nobles âmes.
Restés là tout un
an, sans cesse nous usâmes
De bons vins et de
chairs; mais l'année à sa fin,
Les heures, longs
jours, mois, étant passés enfin,
Mes amis m'appelant
me parlent en ces termes :
« Noble Ulysse,
s'il est dans ton sort d'être aux termes
De revoir ta demeure
et ton toit élevé,
Songe à ton sol
natal, et que tu sois sauvé. »
Donc chacun
d'eux à moi s'adresse de la sorte
Et convainc mon
grand cœur, et là, sans qu'on en sorte,
Jusqu'au soleil
couchant nous nous régalons tous
Tout le jour à
foison de chairs et de vin doux.
Au coucher du
soleil, quand survient la nuit sombre,
Tous les miens
endormis dans le palais plein d'ombre,
Au beau lit de Circé
je monte, et là je veux,
En pressant ses
genoux, lui dire tous mes vœux :
« Circé,
fais-moi partir, observe ta parole,
Partir vers mes
foyers où mon cœur toujours vole,
Autour de moi les
miens en pleurs me consumant
Mon cher cœur, dès
que toi t'éloignes un moment. »
En ces mots me
répond Circé noble déesse :
« Divin fils de
Laërte, Ulysse plein d'adresse,
Ne restez plus chez
moi par force, mais d'abord
Par un autre voyage
allez au sombre bord,
Au séjour de Pluton,
de Proserpine auguste,
Afin d'interroger
une âme ferme, juste,
Tirésias Thébain,
aveugle augure à qui
Proserpine accorda
que même mort, seul lui
Fût sage,
intelligent où voltigent les ombres. »
Elle dit ; mon
cher cœur se brise à ces mots sombres,
Je pleure sur la
couche, il me semble odieux
De vivre encore et
voir le soleil radieux;
Las de pleurs, me
roulant, je lui tiens ce langage :
«
Circé, qui donc sera mon guide en ce voyage,
Car en vaisseau
jamais, du moins jusqu'à ce jour,
Nul chez Pluton ne
fut visiter son séjour ? »
En ces mots me
répond Circé noble déesse :
« Divin fils de
Laërte, Ulysse plein d'adresse,
Il ne faut nullement
qu'un grand désir d'avoir
Un guide à ton
vaisseau doive autant t'émouvoir ;
Ayant dressé le mât,
dans l'air les voiles blanches
Se déployant, toi
reste en repos sur les planches,
Le souffle de Borée
alors te portera ;
Mais dès que ton
navire au terme abordera
A travers l'Océan
vers de petits rivages,
Près de peupliers
hauts et de saules sauvages,
Dans les bois
consacrés à Proserpine, alors
Fais voguer ton
vaisseau sur l'Océan sans bords,
Afin qu'abordant là,
toi-même sur la rive
Descendes aussitôt
que ton navire arrive,
Pour te rendre au
séjour humide de Pluton ;
Ensemble dans ces
lieux le Pyriphlégéton
Et le Cocyte, un
bras des ondes du Styx, coulent
Dans l'Achéron,
tous deux ces fleuves unis roulent
Avec bruit près d'un
roc ; approches-en tout droit,
Héros, comme je
dis, et creuse en cet endroit
Une fosse en tous
sens grande d'une coudée ;
Et que la terre
autour soit partout inondée
D'une libation pour
tous les morts, d'abord
D'hydromel puis de
vin, puis verse sur le bord
L'eau blanche de
farine, et prie avec instance
Les vains spectres
des morts, dis qu'en ta résidence,
Arrivé dans Ithaque,
en offrande sera
La plus belle
génisse, un bûcher s'emplira,
Le plus beau bélier
noir sera mis en offrandes
A Tirésias seul ; et
par nations grandes
Les morts priés,
immole et brebis et bélier,
Les tournant vers l'Érèbe,
allant d'abord prier
Vers le courant du
fleuve, ayant tes mains tendues
Où les âmes des
morts devront s'être rendues.
Dis à tes compagnons
que mis sur le terrain,
Les animaux tués par
le cruel airain,
Soient dépecés,
rôtis, en priant, comme est juste,
L'excellent dieu
Pluton et Proserpine auguste ;
Là reste, glaive en
main, n'admets nul spectre au bord
Avant d'interroger
Tirésias d'abord,
Ce devin chef
viendra, dira la route à prendre,
Sa longueur et
comment par mer chez toi te rendre. »
Elle dit, et
l'Aurore au trône d'or paraît ;
De tunique et
manteau Circé là me parait ;
Elle vêt une robe
immense et fine, blanche,
Un voile sur sa
tête, elle entoure sa hanche
D'une ceinture d'or
; dans son palais je cours,
Avec douceur aux
miens j'adresse ce discours :
« Partons, plus
de doux somme, allons, que l'on s'éveille
Car l'auguste Circé
déjà me le conseille. »
J'ai dit ; j'ai
convaincu tous leurs cœurs généreux ;
Je n'emmène les
miens sans perdre l'un d'entre eux :
Un certain Elpénor,
non le plus brave en guerre,
Le moins âgé de tous
et qui ne brillait guère
Par fermeté
d'esprit, ivre à l'écart alla
Dans les sacrés
palais de Circé, couché là,
Cherchant le frais ;
au bruit du mouvement des autres,
Au tumulte il
s'élance aussitôt vers les nôtres,
Oubliant l'escalier,
va droit du toit au sol
Tomber en se brisant
les vertèbres du col ;
Son âme chez Pluton
aussitôt va descendre ;
Je dis à tous les
miens venant vers moi se rendre :
« Peut-être
pensez-vous qu'au cher pays on part.
Vers nos foyers ?
Circé nous envoie autre part,
Chez Pluton,
Proserpine, en leur demeure sombre,
Consulter le devin
Tirésias, son ombre... »
Je dis ; leurs
cœurs brisés, tous tirent leurs cheveux,
Tous pleurent, mais
des pleurs ne servent pas leurs vœux ;
Tout en pleurs,
affligés, nous allons vers la rive,
Au navire où Circé
pendant ce temps arrive,
Lie une brebis
noire, un mâle également,
Tout à côté de nous
elle-même aisément
S'étant rendue
alors, car quelle vue humaine,
Si ne le veut un
dieu, verrait qu'il se promène.