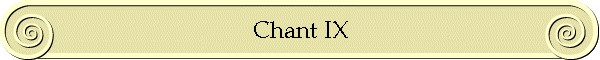RÉCITS
D'ULYSSE. - LE CYCLOPE POLYPHÈME.
L'ingénieux
Ulysse alors ainsi s'exprime :
« Illustre
Alcinoüs, c'est beau, roi magnanime,
D'entendre un tel
chanteur chantant comme les dieux,
Rien n'est plus doux
que voir un peuple entier joyeux,
Des convives à table
et dans ta résidence
Le pain, le vin, les
chairs servis en abondance,
Un échanson versant
d'un cratère ; il n'est rien
De plus beau suivant
moi ; mais tu désires bien
Le récit de mes
maux, pour combler mon martyre !
Quelle chose en
premier, en dernier, vais-je dire ?
Des dieux j'eus tant
de maux ! Sachez mon nom d'abord
Afin que si plus
tard j'échappe au cruel sort,
Même habitant au
loin, je sois votre hôte certe.
Or moi je suis
Ulysse engendré par Laërte ;
Tous disent mon
renom d'adresse, il monte aux cieux ;
J'habite Ithaque
sise au couchant, dans ces lieux
Est le beau mont
Nérite aux feuilles agitées ;
Plusieurs îles en
groupe autour sont habitées :
Samé, Dulichium et
Zacynthe à forêt ;
Bien que basse, elle
en mer est la plus haute, elle est
Au couchant (à
l'écart vers le soleil, l'aurore),
Rocailleuse, et
pourtant bonne nourrice encore
Pour des garçons,
son sol me paraît le plus doux.
La sainte Calypso me
voulant pour époux,
Me retint dans sa
grotte ; en sa demeure ancienne
De même fit Circé d'Ea
magicienne ;
Mais mon cur ne les
crut, tant il n'est plus doux soin
Que patrie et
parents, restât-on même au loin,
Chez un peuple
étranger, en riche résidence.
Mais je dis mon
retour, les maux qu'en abondance,
Quand je partis de
Troie, envoya Jupiter :
M'emportant
d'Ilion, le vent me pousse en mer
Chez les Ciconiens,
j'aborde Ismare ; eux autres
Tués, la ville à
sac, femmes, biens pris, aux nôtres
Tout partagé,
j'engage à fuir vite ; insensés,
Ils boivent trop de
vin, n'obéissent pressés
D'immoler brebis,
bufs à pieds tors, cornes torses ;
Et les Ciconiens
font arriver en forces
Leurs voisins plus
nombreux et plus braves aussi,
Peuplant l'intérieur
; bons cavaliers, ceux-ci,
Fantassins au
besoin, dès l'aurore apparaissent,
Nombreux comme les
fleurs et les feuilles qui naissent
En saison de
printemps, et par un sort affreux,
Jupiter nous destine
à des malheurs nombreux :
Il s'élève un combat
vers nos vaisseaux rapides,
Où nous, de chaque
part, combattons intrépides
A coups de lance, et
tous tout le matin restons,
Tant que croît le
saint jour nous-mêmes résistons,
Repoussons l'ennemi
supérieur en nombre.
Mais lorsque le
soleil se couche et laisse l'ombre,
L'ennemi fait plier
les Grecs, six mis à mort
Sur chacun des
vaisseaux, et nous autres au sort,
Au trépas échappés,
de là nous naviguâmes,
Contents de fuir la
mort, mais navrés dans nos âmes
D'avoir ainsi perdu
nos compagnons chéris ;
Rembarques, nous
voguons après que par nos cris
Sont appelés trois
fois nos amis qui périrent,
Que les Ciconiens
dans le massacre prirent.
Mais dans un
ouragan Jupiter, roi des airs,
Lance aux vaisseaux
Borée et couvre terre et mers
Sous un épais nuage,
et des cieux la nuit tombe,
Nos vaisseaux en
dérive emportés par la trombe
Qui fend notre
voilure en trois, quatre morceaux
Que nous, craignant
la mort, rentrons dans nos vaisseaux
Vite tirés à terre
où las, rongeant nos âmes,
Couchés deux jours
et nuits toujours nous reposâmes.
L'Aurore aux
beaux cheveux fait le troisième jour,
Le mât, la blanche
voile en l'air, de ce séjour
Nous partons en
suivant le vent et le pilote ;
Vers mon sol
j'arrivais sain et sauf sur ma flotte,
Quand Borée et le
cours des flots m'éloignant là
De l'île de Cythère,
alors ma flotte alla
Tourner le Malée où
la tempête haineuse
Neuf jours m'ayant
poussé sur la mer poissonneuse,
Le dixième on monta
sur le sol qu'habitaient
Les Lotophages qui
de fleurs s'alimentaient ;
Nous y faisons de
l'eau, dînons sur le rivage,
Près des vaisseaux
goûtons nourriture et breuvage ;
Je fais partir
devant deux de mes compagnons
Dont j'avais fait le
choix et nous leur adjoignons,
En troisième, un
héraut, pour apprendre quels hommes,
Mangeurs de pain,
peuplaient cette terre où nous sommes.
Les nôtres partent
vite, aux Lotophages vont
Se mêler :
N'apprêtant leur trépas, ceux-ci font
Qu'ils goûtent du
lotus qu'ils offrent, mais quiconque
En goûte le doux
fruit, ne désire plus onque
Revenir en message
et rentrer près de nous ;
Mais au milieu des
gens lotophages eux tous
Veulent rester,
cueillir ce lotus plein de charmes,
Oublier le retour ;
mais moi, malgré leurs larmes,
Je les mène aux
vaisseaux où les ayant traînés,
Sur les bancs des
rameurs je les tiens enchaînés
Au fond de nos
vaisseaux et je commande aux autres,
Mes compagnons
chéris, qu'en hâte tous les nôtres
Soient embarqués de
peur qu'un d'entre eux, à son tour,
Mangeant de ce
lotus, n'ait l'oubli du retour.
Tous embarqués,
assis en file sur les planches,
Frappent des avirons
la mer aux ondes blanches.
De là, le cur
navré, voguant plus loin, bientôt
Nous arrivons au sol
d'un peuple orgueilleux, haut,
De ces Cyclopes qui,
sans lois ni prévoyance,
Dans les dieux
immortels mettent leur confiance,
Ne plantent de leurs
mains et ne labourent pas ;
Sans semis, sans
labour, tout pousse sous leurs pas :
Les blés, orges, la
vigne à vin, à grappe énorme,
Que l'eau de Jupiter
fait naître ; or sans qu'on forme
De lois ni
d'assemblée où l'on décide entre eux
Qui vivent sur les
monts, dans le fond d'antres creux,
Sans s'occuper
d'autrui, chacun dans sa caverne
Commande à ses
enfants, aux femmes qu'il gouverne.
En dehors et le long
du port du continent
Des Cyclopes, ni
près ni loin, presque attenant,
Est un îlot boisé,
plein de chèvres sauvages,
Naissant là, car les
pas d'hommes sur ces rivages
Ne font ni s'écarter
ni fuir ces animaux,
Et jamais les
chasseurs se donnant tant de maux
A parcourir les bois
aux sommets des montagnes,
Ne pénètrent dans
l'île où toujours les campagnes,
Sans troupeaux ni
labours, qu'on n'ensemence pas,
Sont veuves
d'habitants et servent aux repas
De la bêlante chèvre
; au reste, les Cyclopes
Ne font pas de
vaisseaux à rouges enveloppes,
N'ayant de
constructeurs qui puissent fabriquer
De bons transports
allant par les mers trafiquer
Dans les cités
d'humains, (suivant les habitudes
Des hommes naviguant
sous plusieurs latitudes) ;
Ils enrichiraient
l'île, elle est bonne, en saisons
Tout croîtrait ;
vers la mer sont de frais doux gazons,
Les vignes n'y
mourraient, le labour dans cette île
Est uni, le dessous
du sol gras et fertile,
Par saison
produirait toujours un bon rapport ;
Une excellente rade
est dans lîle avec port
Où n'est jamais
besoin ni d'ancres ni de câbles ;
Mais ayant abordé
ces rives remarquables,
Chaque navigateur
peut, si c'est son plaisir,
En attendant les
vents, séjourner à loisir.
D'un antre en haut
du port une superbe source
Parmi des peupliers
allait prendre sa course ;
Un dieu nous y
conduit, nous abordons le soir,
Nos vaisseaux dans
la brume où rien né peut se voir,
La lune au ciel ne
brille, un nuage l'enferme,
Ni l'île, ni le flot
qui roule à terre ferme,
Rien ne se voit
avant qu'abordent nos vaisseaux ;
La voilure abaissée,
on sort au bord des eaux,
Jusqu'à la sainte
Aurore en ces lieux on repose.
Sitôt qu'a reparu
l'Aurore aux doigts de rose,
Nous admirons cette
île en allant l'observer ;
Filles de Jupiter,
les nymphes font lever
Les chèvres des
coteaux, pour dîner de ma troupe ;
La flotte fournit
d'arcs, d'épieux un triple groupe
Partant en bonne
chasse offerte par un dieu ;
Douze vaisseaux
suivant, chacun prend dans ce lieu
Neuf chèvres, j'en
ai dix pour moi seul ; de la sorte,
Jusqu'au soleil
couchant tout le jour sans qu'on sorte,
Nous restons assis
là, nous régalant bien tous
Et d'abondantes
chairs et de vin pur et doux,
Car n'ayant pas tout
bu, nous possédions encore
Du vin de nos
vaisseaux, puisé de mainte amphore
Quand des Ciconiens
fut pris le saint rempart ;
Nous contemplons ce
sol des Cyclopes, d'où part,
Tout près, une
fumée, et la voix de leurs lèvres
Se mêle aux
bêlements des brebis et des chèvres.
Le soleil s'est
couché, la nuit tombe, et tous mis
Sur le bord de la
mer, nous restons endormis.
La fille du
matin, l'Aurore aux doigts de rose
A peine a reparu
qu'aussitôt je compose
Un Conseil où je
parle aux miens assemblés tous :
« Mes bien chers
compagnons, tous restez ici, vous,
Mais avec mon navire
et les miens, d'où nous sommes
Moi je vais essayer
de voir quels sont ces hommes,
S'ils sont injustes,
durs, méchants, ou dans ces lieux
S'ils sont
hospitaliers et s'ils craignent les dieux. »
Ayant dit, je
m'embarque, en même temps j'invite
Mes amis à me suivre
et démarrer bien vite ;
Montés, mis sur les
bancs, tous à coups d'aviron ?
Frappent la blanche
mer et bientôt nous virons
Et voyons sur la
rive une caverne haute
Qu'ombragent des
lauriers, maint bétail sur la côte,
Des chèvres, des
brebis à l'étable, une cour
En forts et profonds
blocs construite tout autour,
Grands peupliers,
longs pins ; là reste un homme unique,
Monstrueux, à
l'écart, être d'esprit inique,
Qui paissait son
bétail et solitaire allait ;
Cet énorme prodige
et tel ne ressemblait
A l'homme qui de
pain se nourrit sur la terre,
Mais au sommet boisé
d'un haut mont solitaire.
J'ordonne à mes amis
de n'avancer ailleurs,
De garder le
vaisseau, puis les douze meilleurs
Choisis, je pars ;
j'avais une liqueur vantée,
Une outre de vin
noir, don du fils d'Evanthée,
Maron, qui dans
Ismare avait gardé ce vin ;
Lui, prêtre
d'Apollon, fut, comme être divin,
Sauvé par nous au
fond d'un saint bois, forêt dense
De Phébus où ce
prêtre avait en résidence
Sa femme et ses
enfants ; il me fit offre encor
D'autres superbes
dons, sept brillants talents d'or,
Un cratère d'argent,
douze amphores qu'il puise
Toutes d'un doux vin
pur, boisson divine, exquise ;
Les femmes,
serviteurs chez lui l'ignoraient tous,
Seuls lui, sa chère
épouse y savaient ce vin doux,
Seuls avec
l'intendante, et lorsque dans leur groupe
Ils en buvaient,
lui-même en versait une coupe
Dans vingt mesures
d'eau, certe un parfum divin
S'exhalait du
cratère et s'abstenir du vin
Ne charmait guère.
Moi là j'emportais une outre
Très-grande de ce
vin, et dans un sac, en outre,
Des vivres,
présumant dans mon cur généreux
Qu'il pourrait
survenir quelque homme vigoureux,
Un sauvage ignorant
les lois et la justice.
Nous pénétrons
dans l'antre, il n'est dans sa bâtisse ;
Vers un gras
pâturage il paissait son bétail ;
Entrés, nous
admirons chaque chose en détail,
Chaque claie à
fromage, étables sans lacune,
Pleines d'agneaux,
chevreaux, là femelles, chacune
A part, vieilles à
part, les adultes aussi,
Et les jeunes de
même, et les vases, ici,
Étant tout
ruisselants de petit-lait, ces vases,
Tous bassins faits
par lui pour traire, ayant leurs cases.
Mes amis me priaient
de partir tout d'abord,
Et des fromages
pris, de retourner à bord
De notre prompt
navire, en chassant des étables
Des agneaux et
chevreaux destinés à nos tables,
Et de nous embarquer
sur l'eau salée, avis
Le plus avantageux,
mais que je ne suivis,
Voulant le voir
lui-même et voir s'il devait faire
Des dons d'hôte ? or
le voir ne dut nous satisfaire.
Nous faisons du
feu là, puis une offrande aux dieux,
Nous prenons et
mangeons du fromage en ces lieux
Et l'attendons assis
; rentrant de paître, il porte
Pour souper un lourd
faix de bois sec qu'à la porte
Il jette avec un
bruit qui nous effraye, au fond
Nous fuyons vite ;
il chasse en son antre profond
Son gras bétail à
traire, en laissant hors de l'antre
Les mâles, béliers,
boucs, et lui-même enfin entre,
Lève un bloc de
clôture énorme et d'un grand poids,
Que vingt-deux
chariots très-forts tous à la fois
N'eussent levé du
sol, tant haute est cette roche
Que lui-même soulève
et sur l'entrée approche ;
Puis assis, faisant
tout avec grand soin, trayant
Les chèvres, les
brebis qui bêlent, envoyant
Un petit sous
chacune, il fait cailler et pose
La moitié du blanc
lait, en éclisses dispose
La seconde moitié
dans des pots pour servir
Au souper, à la soif
qu'il devrait assouvir.
Tous ses travaux
bien faits, en y prenant bien garde,
Il allume du feu, là
nous voit, nous regarde,
Et nous interrogeant
ainsi s'adresse à nous :
« Eh quoi ! des
étrangers !... Et qui donc êtes-vous ?
En traversant les
mers, d'où sur l'humide route
Venez-vous, dans
quel but arrivez-vous ? Sans doute
Eu pirates errants,
exposés aux dangers,
Portez-vous le
ravage aux peuples étrangers ? »
Il dit, et de
frayeur de ce monstre à voix forte
Notre cur
défaillant, je réponds de la sorte :
« Grecs de Troie
égarés par les vents sur la mer,
Par différents
chemins nous rentrons, Jupiter
Sans doute ainsi le
veut, et nous nous vantons d'être
Guerriers
d'Agamemnon dont Atrée est l'ancêtre,
Et sous le ciel sa
gloire est immense à présent,
Tant grande est la
cité qu'il prit en détruisant
Des peuples
très-nombreux, et nous venons, nous autres,
A tes pieds,
espérant quel que don d'hôte aux nôtres,
Comme on en fait ;
très-bon, respecte les dieux, nous
Sommes des
suppliants tombant à tes genoux ;
Jupiter est vengeur
de l'hôte vénérable. »
Je dis ; il me
répond d'un cur inexorable :
« Étranger,
es-tu fou, viens-tu de lointains lieux,
Toi m'invitant à
craindre, à respecter les dieux ?
Aux Cyclopes que
font Jupiter à l'Égide
Et dieux heureux !
Vigueur plus forte en nous réside ;
Sans craindre
Jupiter, à toi non plus qu'aux tiens
Nul pardon, si
moi-même en mon cur je n'y tiens.
Mais quand tu vins
où donc resta ton beau navire ?
Est-ce aux confins,
plus près, veuille ici me le dire. »
Il dit pour
m'éprouver, mais moi sachant beaucoup,
Je devine et rusant
je réponds tout à coup :
« Le lançant aux
confins de votre territoire
Et contre des
rochers auprès d'un promontoire,
Neptune puissant
dieu fracassa mon vaisseau,
Que le vent de la
mer emporta par morceau,
Les miens et moi
fuyant une perte effroyable. »
Je dis ces mots,
et lui d'un cur impitoyable
Ne me répondant
rien, en s'élançant près d'eux,
Met sur mes
compagnons ses mains, en saisit deux,
Comme de jeunes
chiens contre terre les frappe,
Et coulant sur le
sol leur cervelle s'échappe ;
Leurs membres
dépecés, il retourne s'asseoir
Et faisant les
apprêts de son repas du soir,
Mange comme un lion
sauvage, carnivore,
Sans laisser rien
des chairs, des entrailles, dévore
Jusqu'aux os pleins
de moelle... En pleurs nous regardons
Ces horribles
forfaits, et navrés nous tendons
Les mains vers
Jupiter, le désespoir dans l'âme.
Mais lorsque le
Cyclope eut, sans souci de blâme,
Son vaste estomac
plein, et dès qu'il eut mangé
La chair humaine, il
but du lait non mélangé,
Puis s'étendit dans
l'antre au milieu de ses bêtes ;
Et moi dans mon
grand cur mes réflexions faites,
Près de ma cuisse
ayant tiré mon glaive aigu,
Vais où le péricarde
au cur est contigu,
En tâtant de la
main, lui frapper la poitrine,
Quand un autre
penser me retient, me chagrine :
Nous eussions péri
tous là d'un affreux trépas,
Car certes de nos
mains nous tous ne pouvions pas
Écarter le lourd roc
remis au seuil encore,
Et tous nous
attendons en pleurs la sainte Aurore.
L'Aurore
matinale aux doigts rosés paraît ;
Il allume son feu,
fait tout avec soin, trait
Ses belles bêtes,
pousse un petit sous chacune,
Achève ses travaux
en hâte et sans lacune,
Prend deux de mes
amis, en déjeune, puis sort
Son gras bétail de
l'antre, enlève, sans effort,
L'immense roc du
seuil, le remet comme on place
Un couvercle au
carquois, puis avec fracas chasse
Son gras bétail au
mont, me laissant arranger,
Ourdir en moi des
maux si je puis me venger,
Si m'exauce Minerve,
et je crois mieux conçue
La conduite suivante
: Une immense massue
D'olivier vert, pour
lui coupée et s'étendant
Dans l'antre, est à
sécher, et nous la regardant,
La comparions au mât
d'un navire de charge,
A vingt rangs de
rameurs, navire vaste et large,
Traversant le grand
gouffre, et d'aspect à peu près
Aussi long, aussi
gros ; moi-même allant auprès,
J'en coupe la
longueur d'une brasse à ma guise,
Donne à mes
compagnons l'ordre que l'on l'aiguise ;
Ils l'unissent et
moi j'en affile le bout,
Puis la tourne à la
flamme en la tenant debout
Dans un ardent
foyer, puis je la dissimule
Sous du fumier dans
l'antre où le tas s'accumule ;
J'ordonne que chacun
tire au sort en ce lieu
Pour oser avec moi
plonger dans l'il ce pieu,
Lorsque le doux
sommeil vers lui viendra se rendre ;
Au sort tombent tous
ceux que j'aurais voulu prendre
Et moi-même choisir
tous les quatre à la fois,
Puis moi-même avec
eux suis pris cinquième au choix.
Conduisant ses
brebis à belle laine, il rentre
Le soir, chasse bien
tout son gras bétail dans l'antre,
Dans la cour vaste
aucun n'étant laissé dehors,
Soit par l'ordre
d'un dieu, soit qu'il pressente alors.
Il lève et met le
bloc pour clore, puis va traire
Chèvres, brebis
bêlant, au pis de chaque mère
Il envoie un petit
et ne néglige rien,
Il fait, achève
tout, et s'en acquitte bien,
Comme il convient se
livre aux soins de toute espèce ;
Deux de mes
compagnons saisis, il les dépèce
Pour son repas du
soir ; vers lui je me rendis,
Une coupe de vin à
la main, je lui dis :
« Tiens, bois du
vin, Cyclope, après la chair humaine
Goûte cette liqueur
que mon navire amène,
Moi je t'en
apportais une libation,
Si par pitié pour
moi, toi vers ma nation
Eusses voulu me
rendre ; en fureur, ta conduite
Est folle,
intolérable, et comment donc ensuite
Te viendrait quelque
autre homme, en agissant à tort ?»
Je lui dis, il
accepte et boit, réjoui fort,
Demande de nouveau
de la boisson si bonne :
« Veuille m'en
redonner, encore une fois donne ;
Et dis-moi donc ton
nom, fais-m'en part à présent,
Que pour te rendre
heureux je te fasse un présent,
Un don hospitalier ;
notre terre fertile
Aux Cyclopes produit
un bon vin qu'en cette île
Les eaux de Jupiter
leur font croître très-bien ;
Mais c'est une
ambroisie, un nectar que le tien. »
Il dit, je lui
redonne alors du vin qu'en outre
Trois fois je lui
reporte et lui verse de l'outre ;
Trois fois dans sa
sottise il but; de ses esprits
Quand le vin
s'empara, doucement je repris :
« Tu veux savoir
mon nom d'illustration haute,
Cyclope, eh bien, je
dis, mais offre un présent d'hôte ;
Personne c'est le
nom que me donnent chez nous
Et mon père et ma
mère et mes amis eux tous. »
Je dis, il me
répond d'un cur qui ne raisonne :
« Pour don
d'hôte, en dernier je mangerai Personne,
Après ses
compagnons, tous eux autres d'abord. »
Il dit, puis se
renverse, en arrière se tord
Sur son épaisse
nuque, et bientôt l'enveloppe
Le sommeil domptant
tout, le gosier du Cyclope
Rendant chairs
d'homme et vin par éructation.
Moi j'enfonce le
pieu jusqu'à combustion
Dans le monceau de
cendre et j'appelle à mon aide
Tous les miens pour
que nul à la frayeur ne cède,
Ne s'éloigne de moi,
puis quand dans le foyer
Le pieu d'olivier
va, bien que vert, flamboyer,
Et déjà brille, un
dieu nous donnant grand courage,
Et tous mes
compagnons formant mon entourage,
Je tiens, l'ôtant du
feu, l'olivier dont le bout
Appuie au haut de
l'il où d'en haut moi debout
Le tourne ; et comme
un homme, en perçant une poutre,
Tient aussi la
tarière, elle est saisie, en outre,
Par d'autres mis
plus bas et la faisant mouvoir
Tous avec la
courroie, ou peut alors la voir
Tourner toujours ;
de même en ce moment la branche,
Aiguisée au feu,
tourne en son il d'où s'épanche
Le sang autour du
pieu qui brûle, et les sourcils,
Et toute la paupière
autour de l'il, les cils
Brûlent par la
vapeur, la prunelle aussi grille,
La racine de l'il
par la chaleur pétille ;
Trempant le fer, ce
qui le rend fort de nouveau,
Le forgeron soudain
plonge en une froide eau
Une grande coignée,
une hache, et cette onde
Siffle violemment,
de même siffle, gronde
Son il autour du
pieu d'olivier ; il poussait
D'affreux
gémissements, le roc retentissait ;
Nous fuyons tous de
peur, lui de l'il se relire,
Jette le pieu
sanglant, il endure un martyre,
Il appelle à grands
cris les Cyclopes qui sont
Dans les antres
voisins sur la cime du mont ;
A ses cris tous en
foule accourent à son antre,
Lui demandent quel
mal auprès de lui-même entre :
« Polyphème,
pourquoi pousser un cri pareil,
Dans la divine nuit
nous privant de sommeil ?
Un mortel
chasse-t-il ton bétail qu'il te vole,
Est-ce que par la
ruse ou la force on t'immole ? »
Polyphème à son
tour leur répondit ainsi :
« Rusé, non
fort, Personne, amis, m'immole ici. »
Alors disent
tous ceux que sa voix importune :
« Si ne te nuit
personne, implore donc Neptune,
Du puissant Jupier
on n'évite les maux. »
Il sont dit, et
s'en vont, mon cur rit à ces mots,
Mon nom, ma bonne
ruse ont trompé... Vite il tâte,
Gémissant, souffrant
bien, il soulève à la hâte
Le roc du seuil,
s'assied, tend les mains pour saisir
Qui parmi ses
troupeaux va sortir, son désir
Est que j'en sois si
fou ; mais là je délibère
Pour obtenir le
mieux : Que de mort je libère
Mes compagnons et
moi qui trame avec grand soin,
Comme on fait pour
la vie, un grand mal n'étant loin ;
Tel est pour moi le
mieux : Là sont, de haute espèce,
De gras beaux
béliers bruns à la toison épaisse ;
Je les lie en
silence avec de longs osiers,
Sur lesquels dort le
monstre, et j'unis trois béliers,
Dont celui du milieu
porte un homme, les autres
Aux côtés et
masquant dans la marche les nôtres ;
Moi du plus beau
bélier prends le dos, me roulant
Sous le ventre velu,
m'y tiens en y coulant,
Entrelaçant mes
mains dans la divine laine,
Et d'un cur
patient, en pose aussi vilaine,
Nous attendons
l'Aurore, et dès qu'elle a paru,
Tout le mâle bétail
pour paître est accouru,
Les femelles bêlant
non traites dans l'étable,
Leurs pis gonflés ;
brisé d'un mal insupportable,
Et leur tâtant le
dos, leur maître, l'insensé !
Ne voit comment
chacun de nous est enlacé
Sous le poitrail
laineux ; à la fin se présente,
Sort le bélier
chargé de sa toison pesante
Et de moi dont la
ruse habilement s'ourdit,
Et le fort Polyphème
en le tâtant lui dit :
« Bélier chéri,
pourquoi ne franchis-tu les portes
Que dernier du
troupeau, jamais tu ne te portes
Derrière les brebis,
mais marchant à grands pas,
De beaucoup le
premier, tu ne t'arrêtes pas,
Broutant les tendres
fleurs de l'herbe, et sur les rives
Toi le premier
toujours à la rivière arrives ;
Vers l'étable le
soir tu veux rentrer premier,
Au contraire à
présent tu marches le dernier ;
Regretterais-tu donc
l'il de ton pauvre maître,
Qu'avec ses
compagnons tous gens pervers, un traître
Aveugla, par le vin
m'ayant dompté l'esprit,
Personne, dont la
perte est certaine, il périt,
Si pensant comme
moi, doué de voix toi-même,
Tu dis où peut
l'atteindre ici ma force extrême ;
D'un coup contre le
sol son cerveau saccagé
Serait épars dans
l'antre, et mon cur soulagé
Des maux qui me sont
faits par ce Personne lâche ! »
Cela dit au
bélier, au dehors il le lâche ;
Lorsque l'étable et
l'antre enfin sont un peu loin,
Ayant lâché d'abord
mon bélier, j'ai le soin
De détacher aussi
mes amis que je presse ;
Nous pressons,
détournons le bétail gros de graisse,
Jusqu'à notre navire
où nos chers compagnons
Aiment à nous
revoir, nous qui les rejoignons
Échappant le trépas
; mais sur ceux morts on pleure,
Je défends de gémir
et j'ordonne sur l'heure,
D'un signe des
sourcils, que l'on embarque à bord
Le nombreux beau
bétail, puis, cela fait d'abord,
Sur l'eau salée on
vogue, alors que tout mon monde
Est sur les bancs,
frappant des rames la blanche onde.
Quand je suis aussi
loin que peut porter la voix,
Pour l'insulter je
crie au monstre que je vois :
« Cyclope,
assurément avec ta force affreuse,
Tu n'aurais dû
manger dans ta caverne creuse
Les pauvres
compagnons d'un homme sans vigueur ;
Donc tes cruels
forfaits méritaient la rigueur
De la punition qui
te devait atteindre,
Toi, misérable,
injuste au point de ne pas craindre
De dévorer chez toi
des hôtes y venant ;
Jupiter, tous les
dieux t'ont puni maintenant. »
Je dis, sa
fureur croît, il arrache une roche
Qu'il lance au beau
vaisseau, du gouvernail approche,
Et la mer qui
bouillonne, en reflux derechef
Amène vers le bord
notre superbe nef ;
Moi, longue perche
en mains, vire et d'un signe invite
Mes amis à ramer
pour qu'un malheur s'évite ;
Tous rament se
penchant ; deux fois plus loin du bord,
Je reparle au
Cyclope, et m'entourant d'abord,
Chacun des miens
m'arrête, en doux mots me supplie :
« Quoi ! tu veux
courroucer ce sauvage, ô folie !
Quand d'un trait
dans la mer il a fait recourir
Le vaisseau jusqu'au
bord où nous pensions mourir !
Si l'un de nous dit
mot ou fait qu'un cri s'échappe,
Qu'avec un roc aigu
qu'il lance au loin il frappe,
Il nous fracassera
la tête et le vaisseau. »
Ces mots n'ont
convaincu mon grand cur, de nouveau
Et d'un cur furieux
je dis à Polyphème :
« Cyclope, si
quelqu'un t'interroge toi-même
Sur l'aveugle il
hideux, dis que ta cécité
Vient d'Ulysse
d'Ithaque, abatteur de cité. »
Je dis et
gémissant en ces mots il réplique :
« Grands dieux !
l'ancien oracle à moi-même s'applique :
Par un excellent
homme, un augure divin,
Télème fils d'Euryme,
oui, le meilleur devin,
Devenu vieux chez
nous, la chose fut prévue
Que moi des mains
d'Ulysse ainsi perdrais la vue ;
Mais j'attendais
toujours qu'ici fût arrivé
Un superbe mortel,
grand, d'un corps élevé,
Et qui fut revêtu de
vigueur admirable ;
Mais un homme petit,
sans force, un misérable,
M'a privé de mon
il, me domptant par le vin...
Mais ici viens,
Ulysse, approche, non en vain
De l'hospitalité je
t'offrirai l'hommage,
J'inviterai Neptune
à faire sans dommage
S'accomplir ton
retour, car je suis son enfant,
Et lui d'être mon
père est fier et triomphant,
Et s'il le veut, lui
seul fera que mon mal cède,
Sans nul des dieux
heureux ni des mortels en aide. »
Il a dit ; à mon
tour je parle sur ce ton :
« Puisse-je
t'immoler, t'envoyer chez Pluton
Comme ne guérira ton
il Neptune même. »
Je dis : ses mains
au ciel plein d'astres, Polyphème,
Priant le roi
Neptune, ainsi lui dit ses vux :
« Veuille bien
m'exaucer, Neptune aux noirs cheveux,
Si je suis vraiment
tien, dieu qui cernes la terre,
Si toi-même,
Neptune, es fier d'être mon père :
Que le fils de
Laërte Ulysse grand guerrier,
Habitant dans
Ithaque, ah ! ne rentre au foyer ;
Si son sort est de
voir les siens et qu'il ne meure,
Et qu'il doive
rentrer dans sa belle demeure,
Sur son sol
paternel, qu'il n'y soit donc rendu
Que misérablement et
tard, ayant perdu
Tous ses chers
compagnons, étant forcé de prendre
Un navire étranger,
et qu'en venant s'y rendre,
Dans sa demeure
encore il trouve aussi des maux ! »
Neptune aux noirs
cheveux, qu'il prie, entend ces mots ;
Le monstre arrache
et lance une plus grosse roche
Derrière le navire,
au gouvernail, tout proche ;
La mer bouillonne,
un flot par son reflux au bord
Contraint le beau
navire à retourner d'abord.
Mais nous rentrons à
l'île où nos beaux vaisseaux autres
Sont ensemble, où
sans cesse en pleurs sont tous les nôtres
Nous attendant assis
; dès que nous abordons,
Nous tirons le
vaisseau sur terre et descendons
Le bétail du
Cyclope, entre tous en partage,
Mes brillants
compagnons veulent qu'on m'avantage,
Me donnent le bélier
que j'immole en ces lieux
Au puissant Jupiter
le souverain des dieux ;
Pour ce fils de
Saturne au feu je mets les cuisses ;
Mais sans se soucier
là de mes sacrifices,
Il veut faire périr
tous mes compagnons chers,
Et tous mes beaux
vaisseaux. Nous régalant de chairs,
De vin doux,
jusqu'au soir où l'on dort sur la rive.
La matinale Aurore
aux doigts de rose arrive,
Je dis de démarrer,
sur les bancs des vaisseaux
Tous à coups
d'avirons frappent les blanches eaux ;
Contents de fuir la
mort, mais tristes dans nos âmes
Pour nos amis
perdus, plus loin nous naviguâmes.