|
 |
| |
|
ARGUMENT DU
LIVRE XIX.
LE premier soin
d'Ulysse, resté seul avec son fils, est d'enlever les armes qui
étoient dans le palais à la disposition des Prétendans, & de les
cacher. Ulysse entretient Pénélope, & dans le récit de ses
aventures imaginaires, assure la Reine qu'il a vu son Époux dans
l'île de Crète, & que son retour est proche. Il va ensuite au bain,
où Euryclée , en le lavant, le reconnaît à la cicatrice d'une
blessure qu'il avoit reçue dans sa jeunesse à la chasse d'un
sanglier.
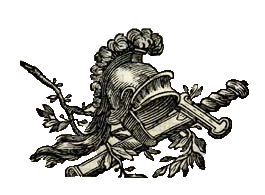 |
|
| |
| |
Ulysse enfin
tranquille & seul avec Pallas,
De ses fiers ennemis
médite le trépas.
Il s'adresse à son
fils : « Hâtez-vous, Télémaque (1),
D'assurer ma
vengeance & la gloire d'Ithaque ;
|
5
|
Hâtez-vous de cacher
aux yeux des Prétendans
Ces armures, ces
traits, ces dards étincelans.
Si leur ame étonnée
en conçoit des alarmes,
La vapeur des foyers
souille & noircit ces armes,
Direz-vous : qui
pourroit reconnoître en ce jour,
|
10
|
Ces faisceaux dont
Ulysse embellit ce séjour
Un autre soin encor
m'intéresse & m'anime ;
Je crains que vos
plaisirs n'enfantent quelque crime,
Que le vin, la
discorde & ses traits dangereux
N'ensanglantent ici
votre hymen & vos jeux.
|
15
|
Le fer attire
l'homme, il l'échauffe & l'excite (2).
Télémaque, à
l'instant, vole & se précipite ;
Empressé d'obéir à
la voix du Héros,
A la sage Euryclée
il adresse ces mots :
Enfermez avec
soin les Femmes de la Reine,
|
20
|
Ces femmes, dont je
crains l'insolence & la haine,
Attendant que ma
main dans un réduit secret,
Ait porté ces
faisceaux que je vois à regret,
Tout couverts de
fumée & blanchis de poussière,
Atteste à nos yeux
l'absence de mon Père.
|
25
|
Affranchi de
l'enfance, il est temps que du moins
Télémaque Aujourd'hui se charge de
ces soins.
Euryclée
aussitôt : « Fasse le Ciel propice
Que vous veilliez
ainsi sur tous les biens d'Ulysse,
O mon fils ! Mais
parlez, nommez qui d'entre nous,
|
30
|
Pour éclairer vos
pas, marchera devant vous.
Ce Vieillard,
dit le Prince ; il me doit cet office :
L'homme que je
nourris s'engage à mon service (3).
Euryclée obéit ;
& marchant à grands pas,
Télémaque & son Père
emportent dans leurs bras
|
35
|
Ces javelots, ces
dards, ces boucliers antiques,
Suspendus en
faisceaux aux voûtes des portiques.
Pallas qui les
devance, un fanal d'or en main,
De feux étincelans
éclaire leur chemin.
Télémaque s'étonne,
& s'écrie : « O mon Père !
|
40
|
Quels rayons
éclatans ! quelle vive lumière
Fait ici resplendir
à mes regards surpris,
Ces colonnes, ces
murs, ces superbes lambris !
Sans doute descendu
de la voûte céleste,
Un Dieu, par ce
prodige, ici se manifeste.
|
45
|
Ne m'interrogez
pas, répond le sage Roi,
D'un silence profond
sachez garder la loi.
Souvent quittant les
Cieux, & traversant la nue,
Les Dieux daignent
ainsi s'offrir à notre vue.
Allez au doux
sommeil abandonner vos sens ;
|
50
|
Je reste ici : je
veux par des discours pressans
Éprouver, consoler &
flatter votre Mère.
Télémaque docile
aux ordres de son Père,
Marche vers le
séjour tout brillant de flambeaux,
Où souvent le
Sommeil lui verse ses pavots.
|
55
|
Ulysse,
resté seul, médite sa vengeance.
Cependant, pour le
voir, Pénélope s'avance ;
De Vénus, de Diane,
elle a tous les appas.
Ses Femmes aussitôt
accourant sur ses pas,
Lui préparent un
siége (4), & desservent les tables
|
60
|
Où s'échauffa
l'orgueil de ses Amans coupables ;
Leur main, pour
ranimer la flamme des foyers,
D'un léger aliment
entretient les brasiers.
Mélantho voit
Ulysse, & sa langue cruelle
Se plaît à
l'accabler d'une injure nouvelle.
|
65
|
Étranger
importun, quoi ! jusque dans la nuit
Ton regard insolent
sans cesse nous poursuit !
Sors, ou crains qu'à
l'instant, pour prix de ton audace,
Ce brandon allumé de
ces lieux ne te chasse.
Ulysse lui lançant
un regard furieux :
|
70
|
Cruelle, mon
aspect offense ici vos yeux,
Dit-il, & ces
lambeaux où règne la misère,
De vos sens délicats
blessent l'orgueil sévère.
Hélas ! je suis la
loi de la nécessité.
Comme vous, j'ai
vécu dans la prospérité ;
|
75
|
Jadis riche &
puissant, au sein de l'abondance,
J'aimois à secourir
la timide indigence ;
Je voyois sur mes
pas, comme au séjour des Rois,
Cent esclaves
choisis accourir à ma voix.
Les Dieux m'ont tout
ravi : dans mon malheur extrême,
|
80
|
J'honore de ces
Dieux la volonté suprême (5).
Mais vous, dont la
jeunesse ainsi que la beauté,
De votre cœur
superbe enfle la vanité,
Craignez de voir
flétrir ces brillans avantages ;
Craignez de voir sur
vous retomber vos outrages ;
|
85
|
Redoutez votre
Reine, & son juste courroux :
Le Ciel lui peut
encor ramener son Époux.
Et, si ce Roi n'est
plus, la main des Destinées
Déjà de Télémaque a
mûri les années :
Il voit tous vos
forfaits, il observe à loisir
|
90
|
Votre orgueil
insensé, qu'il s'apprête à punir.
Soudain, pour le
venger, Pénélope s'écrie :
Malheureuse !
crois-tu, trop long-temps impunie,
Échapper au supplice
& tromper mes regards ?
Lorsque cet Étranger
mérite tes égards,
|
95
|
Quand tu sais qu'en
ces lieux, pleine d'un trouble extrême,
Je viens
l'interroger sur un Époux que j'aime,
Tu l'insultes !
crois-tu que bientôt ton trépas,
De cet outrage amer
ne le vengera pas (6)
Venez, sage
Eurynome, à mes ordres fidèle ;
|
100
|
Qu'un siége,
enveloppé d'une toison nouvelle,
Soit à cet Étranger
par vos mains présenté.
Je veux
l'interroger, l'entendre en liberté.
Eurynome obéit,
& sa main diligente.
Couvre un siége doré
d'une toison brillante,
|
105
|
Le présente au
Vieillard ; Ulysse au même instant
S'assied près de la
Reine, éperdu, palpitant,
Il frémit à la voix
d'une Épouse chérie.
Apprenez-moi
d'abord quelle est votre patrie,
Étranger, lui
dit-elle, & quels lieux, quels parens
|
110
|
Ont, loin de ces
climats, nourri vos premiers ans.
O reine » dit
Ulysse, o vous, dont la sagesse
Est l'exemple du
monde & l'honneur de la Grèce,
De votre auguste nom
l'immortelle splendeur,
Des plus fameux
Héros éclipse la grandeur.
|
115
|
Oui, Reine,
jusqu'aux Cieux votre gloire est montée ;
Vous égalez ces Rois
que la Terre enchantée
Voit gouverner en
paix un Peuple courageux.
L'Équité sur le
trône est assise avec eux,
Aux vœux, du
Laboureur la terre complaisante
|
120
|
Se couvre tous ses
ans d'une moisson brillante ;
L'Automne en
abondance apporte ses présens ;
D'innombrables
troupeaux couvrent au loin les champs ;
Les peuples sont
heureux, & leur bonheur suprême
Atteste l’équité
d'un maître qui les aime (7).
|
125
|
Reine, vous
m'ordonnez de vous entretenir !
Mais daignez
m'épargner un triste souvenir ;
Ne me demandez point
mon nom & ma patrie ;
J'ai trop souffert
de maux, & mon ame attendrie
Ne pourroit devant
vous commander à mes pleurs
|
130
|
Hélas ! il faut
savoir dévorer ses douleurs.
Sous un toit
étranger sied-t-il à l'infortune
D'exhaler sans
réserve une plainte importune.
Peut-être, en vous
parlant, mes yeux de pleurs couverts
N'attireraient sur
moi que des mépris amers.
|
135
|
O
vieillard, dont la voix rappelle à ma pensée
Le souvenir cuisant
de ma splendeur passée (8),
Dit la Reine, les
Dieux m'ont enlevé ces biens,
Depuis qu'il est
parti pour les bords Phrygiens,
Cet Époux, qui
faisoit la gloire de ma vie :
|
140
|
Toute félicité m'est
pour jamais ravie.
En butte à des Amans
dont l'insolent orgueil
Redouble sans repos
mes tourmens & mon deuil,
Le cœur trop occupé
de ma secrète peine,
Je ne puis plus,
fidèle aux devoirs d'une Reine,
|
145
|
Consoler par mes
soins le pauvre & l'étranger,
Écouter mes Sujets,
les voir, les soulager ;
Je ne puis que
pleurer, que regretter Ulysse.
En vain, par les
secours d'un adroit artifice (9),
J'ai voulu différer
ce jour trop odieux,
|
150
|
Qui d'un nouvel
hymen doit voir serrer les nœuds ;
En vain trois ans
entiers j'ai reculé ma perte,
Sans espoir
aujourd'hui, ma ruse découverte
Me contraint à subir
de rigoureuses loix.
Déjà j'entends mon
Fils qui réclame ses droits,
|
155
|
Et qui, dans son
printemps, plein d'une noble audace,
De son Père en ces
lieux veut occuper la place.
Ah ! qui que vous
soyez, daignez m'apprendre enfin
Votre nom, votre
rang, quel fut votre destin (10).
Digne Épouse
d'un Roi renommé dans la Grèce,
|
160
|
Dit Ulysse, pourquoi
m'interroger sans cesse ?
J'obéis ; mais
combien ces touchans souvenirs
Vont coûter à mon
cœur de pleurs & de soupirs !
Eh ! qui pourroit,
long-temps absent de la patrie,
S'occuper sans
regret d'une image chérie,
|
165
|
Lorsqu'on a, comme
moi, sur la terre & les mers
Porté le joug pesant
des maux les plus amers ?
Au sein de l'Océan
est une île fameuse,
Que ceint de toutes
parts une mer écumeuse.
Quatre-vingt-dix
cités dont ses bords sont couverts (11)
|
170
|
Ont différentes
mœurs, un langage divers.
Là commandoit Minos,
ce Roi, de qui la Terre
Admira la justice &
la sagesse austère,
Le confident, l'ami
du Souverain des Dieux.
Là, digne rejeton de
ce Roi glorieux,
|
175
|
Deucalion nourrit
deux fruits de l'hyménée,
Le malheureux
AEthon, l'illustre Idoménée.
Vous voyez devant
vous ce trop fameux AEthon ;
Mon frère, avec les
Grecs, voguoit vers Ilion,
Quand, pressé de se
joindre à la flotte assemblée,
|
180
|
Ulysse fut jeté loin
des rocs de Malée,
Et, des vents
furieux redoutant les efforts,
Vint chercher un
asyle à l'abri de nos ports.
Ce Prince descendit
sur la rive fleurie
Où Lucine a placé sa
demeure chérie ;
|
185
|
Il vola vers nos
murs, réclama l'amitié
Dont mon frère
autrefois avec lui fut lié.
Au nom d'un frère
aimé, j'accours, & je m'empresse
D'offrir à ce Héros
tendresse pour tendresse ;
Je l'amène au palais
; sur lui, sur ses Guerriers,
|
190
|
Je verse, à pleines
mains, les dons hospitaliers.
Jaloux de satisfaire
à ses vœux légitimes,
Je fis couler le
sang des plus pures victimes ;
Et pendant douze
jours que les Tyrans des airs
Lui fermoient à
grand bruit le passage des mers,
|
195
|
Il me vit, par mes
soins, sur cet heureux rivage,
D'un importun délai
consoler son courage.
Ainsi le sage
Ulysse, à des discours trompeurs,
De la vérité même
allioit les douleurs.
Pénélope l'écoute, &
son âme attentive
|
200
|
Se livre toute
entière à sa douleur plaintive.
Ses yeux sondent en
pleurs, comme au sommet des monts,
Les neiges que
l'Hiver entassoit en glaçons,
Fondent à la chaleur
de la féconde haleine
Du Zéphyre léger que
le Printemps ramène (12).
|
205
|
Les fleuves débordés
en ont grossi leur cours.
Ainsi, pleurant
l'objet de ses tendres amours,
Cet objet qui
présent cause encor ses alarmes,
La Reine, en
gémissant, verse un torrent de larmes.
Ulysse, à cet
aspect, de douleur éperdu,
|
210
|
Sent un trouble
nouveau dans ses sens répandu ;
Ses pleurs vouloient
couler, mais son ame plus ferme,
Craignant de se
trahir, avec soin les renferme.
Ses yeux froids &
muets, démentis par son cœur,
De l'ivoire & du fer
ont toute la roideur.
|
215
|
Cependant, quand
la Reine, en ses larmes noyée,
De ses gémissemens
se fut rassasiée :
Étranger, s'il
est vrai que dans des temps plus doux,
Dit-elle, vous ayez
recueilli mon Époux ;
S'il est vrai qu'il
vous dut ce généreux service ;
|
220
|
Parlez : Quels
vêtemens portoit alors Ulysse ?
Quels étoient les
Guerriers qui marchoient près de lui ?
O reine, après vingt
ans de douleurs & d'ennui,
Depuis que ce Héros
a quitté mon rivage,
Comment vous en
tracer une fidèle image ?
|
225
|
Mon esprit cependant
se représente encor
Son long manteau
fermé par une agraffe d'or,
Ce manteau coloré
d'une pourpre éclatante,
Où cent dessins,
tracés par une main savante,
Brilloient de toutes
parts à mon œil confondu.
|
230
|
Là, s'élançoit un
chien sur un faon éperdu :
Le jeune hôte des
bois paroissoit se débattre
Sous le fier ennemi
qui venoit de l'abattre.
Et tout ensanglanté
ranimoit ses efforts,
Pour éviter la dent
qui déchiroit son corps,
|
235
|
Souvent je
contemplai ce travail magnifique.
Mais combien
j'admirois & légère tunique,
Dont le tissu
brillant comme l'astre du jour,
Attachoit tous les
yeux des femmes de ma Cour !
Devoit-il ces
présens aux soins d'une main chère !
|
240
|
Les avoit-il reçus
d'une main étrangère ?
Je ne sais ; car
Ulysse avoit beaucoup d'amis,
A ce fameux Héros
moi-même je remis
Un vêtement de
pourpre, une épée acérée,
Précieux monumens
d'une union sacrée.
|
245
|
Si ma mémoire est
sûre & ne m'abuse pas.
Le fidèle Eurybate
accompagnoit ses pas :
Plus âgé que son
Roi, la vieillesse pesante
Avoit déjà courbé sa
stature imposante.
L'aimable sympathie
avoit formé les nœuds
|
250
|
Qui dans ces heureux
jours les unissoient tous deux.
Pénélope
l'écoute, & ses larmes redoublent.
Mais enfin,
surmontant les douleurs qui la troublent :
Ah ! dit-elle,
Étranger, objet de ma pitié,
Devenez pour mon
cœur un objet d'amitié !
|
255
|
C'est moi qui lui
remis, pour gages de ma flamme,
Ces habits dont mes
mains avoient tissu la trame ;
C'est moi qui me
plaisois moi-même à le parer.
Hélas ! l'affreux
Destin qui vint nous séparer,
Emporta sans retour
mon bonheur & ma joie
|
260
|
Sur les bords
malheureux de la coupable Troie !
O reine, c'est assez
prolonger vos regrets,
Et dans de longs
ennuis consumer vos attraits,
Dit Ulysse ; cessez
de répandre des larmes
Pour cet Époux chéri
qui causa vos alarmes ;
|
265
|
Non que j'ose blâmer
des pleurs si précieux,
Verses pour un
Mortel qu'on dit égal aux Dieux.
Quelle femme jamais,
heureuse Épouse & Mère,
A d'un plus digne
Époux pleuré la perte amère (13)!
Mais calmez vos
douleurs, il voit encor le jour ;
|
270
|
Daignez m'en croire,
il vit, il presse son retour ;
Je le sais, je
l'appris aux rives de l'Épire,
Où le Sort rigoureux
se plut à me conduire :
Je sais que sur ces
bords il parut avant moi,
Qu'il y vécut comblé
de la faveur du Roi ;
|
275
|
Que du peuple en ses
mains les richesses offertes,
Consoloient ses
ennuis & réparoient ses pertes.
Non loin de
Trinacie, il avoit dans les flots
Perdu tout-à-la-fois
Navire & Matelots.
Voilà de son destin
ce que je puis vous dire.
|
280
|
Phœdon, Roi de ces
bords, a daigné m'en instruire (14)
Il me montra
lui-même, avec soin entassés,
L'argent, l'or &
l'airain par Ulysse amassés.
Long-temps, dit-il,
absent de sa chère patrie,
Ce Héros, renommé
par sa rare industrie,
|
285
|
Est allé de Dodone
interroger les bois,
Ces bois où Jupiter
sait entendre sa voix,
Leur demander du
Dieu la volonté sacrée,
Apprendre enfin s'il
doit, rendu dans sa contrée,
Marcher à découvert
ou déguiser ses pas.
|
290
|
Croyez, & cet espoir
ne vous trompera pas,
Que bientôt, par les
Dieux ramené dans Ithaque,
Il reverra & femme &
son fils Télémaque.
S'il faut par des
sermens mériter votre foi,
J'atteste ici des
Dieux & le Père & le Roi,
|
295
|
Et les sacres foyers
du généreux Ulysse,
Qu'il faudra
qu'avant peu ce retour s'accomplisse :
Oui, cette année, au
temps où l'astre dont le cours...
Suit inégalement &
les mois & les jours,
Commencera d'un mois
la carrière nouvelle,
|
300
|
Ulysse reverra son
Épouse fidèle.
Ainsi partait
Ulysse, & la Reine à l'instant :
Puisse-je voir
éclore un jour si consolant,
Lui dit-elle,
Étranger ! mon cœur sauroit vous rendre
Le prix de ce
bonheur que vous daignez m'apprendre.
|
305
|
Comblé de mes
présens & de mon amitié,
Des plus heureux
Mortels vous seriez envié.
Mais hélas !
croyez-en mes trop justes alarmes,
Non, jamais mon
Époux ne tarira mes larmes,
Il ne reviendra
point ; & vous, infortuné,
|
310
|
Vous vivrez en ces
lieux, errant, abandonné.
Eh ! qui dans ce
séjour, respectant la justice,
Consolant
l'étranger, remplaceroit Ulysse,
Lui qui, sur
l'indigent venu dans son palais,
Répandit tant de
sois ses généreux bienfaits !
|
315
|
Vous, poursuivit la
Reine, en appelant ses Femmes,
Attisez ces foyers,
ranimez-en les flammes ;
Préparez l'eau des
bains, dressez un lit pompeux
Où puisse reposer ce
Vieillard malheureux.
Et demain, que vos
soins, au lever de l'Aurore,
|
320
|
Pour ce digne
Étranger recommencent encore ;
Qu'il vienne ici,
baigné, parfumé par vos mains,
Convive de mon Fils,
s'asseoir à ses festins.
Malheur au cœur
méchant de qui l'aveugle audace
Oseroit dédaigner,
outrager sa disgrâce !
|
325
|
Eh !
comment, Étranger, soutiendrois-je à vos yeux
Cet éclat si
flatteur d'un renom glorieux !
Que deviendroit ici
cette haute sagesse
Qui m'avoit,
disiez-vous, sait un nom dans la Grèce,
Si d'informes
lambeaux dont vous êtes vêtu,
|
330
|
M'empêchoient
aujourd'hui d'honorer la vertu ?
Hélas ! nos tristes
jours sont de peu de durée
La vertu donne seule
une gloire assurée.
L'homme injuste,
pour fruit de ses desseins cruels,
Recueille, tant
qu'il vit la haine des mortels ;
|
335
|
Ses richesses, son
rang, ne peuvent l'en défendre.
Est-il mort, on
l'outrage, on insulte sa cendre,
Et cet homme, jadis
si fier de sa grandeur,
Laisse un nom
poursuivi de la publique horreur.
L'homme juste, au
contraire, aimé durant sa vie,
|
340
|
Surmonte la malice &
les traits de l'envie ;
Les bénédictions
accompagnent ses pas,
Et son nom respecté
survit à son trépas.
Ulysse lui répond :
« Auguste Souveraine,
De ces pompeux apprêts épargnez-vous la peine ;
|
345
|
Cet appareil ne sied qu'à la prospérité.
Depuis que le Destin, qui m'a persécuté,
M'a fait abandonner les rivages de Crète,
Combien de fois, au fond de quelque humble retraite,
Et sur un lit grossier appelant le sommeil,
|
350
|
Ai-je en paix attendu le retour du Soleil !
Si le charme du bain peut me flatter encore,
Pénétré des bontés dont votre soin m'honore,
Permettez qu'en ces lieux je ne l'accepte pas
De ces jeunes Beautés qui marchent sur vos pas.
|
355
|
Mais, s'il est près de vous une femme dont l'âge
De l'aimable prudence ait connu l'avantage,
Qui, comme moi, long-temps ait appris à souffrir,
J'en recevrai les soins que vous daignez m'offrir.
Respectable
Vieillard, lui répondit la Reine,
|
360
|
Parmi les Étrangers
que le Sort nous amène,
Jamais mes yeux
n'ont vu de mortel dont la voix,
De l'aimable
Sagesse, ait mieux connu les loix.
Il est dans ma
maison une femme fidèle,
Dont cent sois
j'éprouvai la prudence & le zèle,
|
365
|
Qui reçut dans ses
bras & nourrit de son lait,
Ce Héros malheureux
que je pleure en secret :
C'est elle, dont la
main, par les ans affoiblie,
Viendra plonger vos
pieds dans une onde attiédie,
Euryclée, en vos
mains je remets ce mortel ;
|
370
|
Tout parle en sa
saveur, son destin trop cruel,
Les rides de son
front, sa misère, son âge,
Qui du Roi mon Époux
me retracent l'image.
Tel est peut-être
Ulysse. Hélas ! dans les malheurs,
L'homme vieillit
bientôt sous le poids des douleurs.
|
375
|
Euryclée, à ces
mots, presse sa marche lente,
Et, sur son front courbé portant sa main tremblante,
S'écrie : « O sort funeste ! o désespoir amer !
O mon fils ! eh ! comment le bras de Jupiter,
Indifférent aux soins de ta piété vaine,
|
380
|
Fit-il tomber sur toi tout le poids de sa haine ?
Eh ! qui dans l'Univers, entre tous les mortels,
Jamais de plus de sang honora ses autels
?
Combien tu prodiguois de pompeux sacrifices,
Pour rendre à tes desseins les Dieux toujours propices,
|
385
|
Pour obtenir du Ciel qu'au déclin de tes ans,
Ton fils devînt l'appui de tes pas chancelans
!
Et le Ciel pour jamais t'enlève à ta patrie !
Et peut-être il
t'expose à la langue hardie
De femmes, dont
l'orgueil sans frein & sans pudeur,
|
390
|
Du timide Étranger
outrage le malheur !
Trop semblables,
sans doute, à ces femmes altières
Dont vous avez senti
les insultes amères,
O Vieillard ! vous
craignez, vous livrant à leur main,
D'animer contre vous
leur dépit inhumain.
|
395
|
Vous refusez leurs
soins, vous acceptez mon zèle ;
La sage Pénélope
auprès de vous m'appelle ;
J'obéis à sa voix,
ses ordres me sont doux.
Que j'aime à les
remplir, & pour elle, & pour vous !
Oui, pour vous, o
Vieillard, car il saut vous apprendre
|
400
|
Quel trouble en vous
voyant est venu me surprendre.
Jamais nul Étranger
reçu dans ce palais,
Ne m'offrit mieux
d'Ulysse & la voix & les traits.
Le Roi, sans se
troubler, répond en assurance :
Vous ne vous trompez
point, & cette ressemblance
|
405
|
A qui je dois ici
vos soins officieux,
De ceux qui nous
voyoient, étonnoit tous les yeux.
Euryclée
aussitôt, d'une main diligente,
En un brillant
bassin épanche une eau fumante,
Et mêle une onde
froide à l'onde qui frémit.
|
410
|
Ulysse, que toujours
la Sagesse conduit,
Tournant le dos au
jour que répandoit la flamme,
S'assied près des
foyers ; il rappelle en son âme
La blessure qu'il
porte, & qu'au milieu des bois,
D'un sanglier énorme
il reçut autrefois.
|
415
|
Il craint que de ce
coup la large cicatrice,
Aux regards
d'Euryclée enfin ne le trahisse.
Elle approche, &
déjà sur les pieds du Héros,
Du liquide crystal
elle épanche les flots.
Mais à peine occupée
à verser l'onde pure,
|
420
|
Elle s'arrête, sent,
reconnoît la blessure (15).
Le pied qu'elle
baignoit, échappe de sa main,
Il fuit, &,
retombant dans le vase d'airain,
Le renverse avec
bruit sur la terre humectée.
De joie & de douleur
à la fois agitée,
|
425
|
Elle tremble, & les
pleurs obscurcissent ses yeux.
Mon cher fils,
lui dit-elle, objet de tous mes vœux !
Ah ! vous êtes
Ulysse. Eh ! comment, o mon Maître,
Mon amour si
long-temps put-il vous méconnoître !
A ces mots, ses
regards vers la Reine adressés,
|
430
|
Expriment les
transports de ses sens oppressés ;
Sa voix, parmi les
pleurs se faisant violence,
Lui veut de son
Époux annoncer la présence.
Mais Pallas, qui
conduit tous ces évènemens,
Porte ailleurs de la
Reine & l'esprit & les sens.
|
435
|
D'une main, le Héros
industrieux & sage,
A la voix d'Euryclée
interdit le passage,
Et de l'autre à
l'instant l'attirant près de lui :
Voulez-vous me
trahir & me perdre aujourd'hui
O vous par qui j'ai
vu mon enfance nourrie,
|
|
440 |
Dit-il. Après vingt
ans, je revois ma patrie :
Taisez-vous,
arrêtez, & ne m'exposez pas
Aux regards
dangereux attachés à mes pas ;
Ou, de mes ennemis
consommant la défaite,
Je saurai bien punir
votre langue indiscrète.
|
|
445 |
Euryclée aussitôt
: « Ah ! mon fils, ah ! mon Roi,
Laissez cette
menace, & comptez sur ma foi.
Vous savez que mon
cœur est ferme, inébranlable,
Que le marbre ou
l'acier est moins impénétrable (16)
Écoutez, quand les
Dieux couronnant vos travaux,
|
|
450 |
Livreront à vos
coups vos insolens rivaux,
Des Femmes du palais
vous apprenant les crimes,
Je vous puis
aisément désigner vos victimes.
Épargnez-vous
ces soins : lorsqu'il en sera temps,
Je saurai, dit le
Roi, par des traits éclatans,
|
|
455 |
Distinguer les
objets de ma juste vengeance.
Confiez-vous aux
Dieux, & gardez le silence.
Euryclée obéit ;
elle sort, & soudain
Portant une onde
pure au fond d'un grand bassin,
Du liquide crystal
vient réparer la perte.
|
|
460 |
Ce nouveau bain
s'achève, & le fils de Laërte,
Par les mains
d'Euryclée avec soin parfumé,
Se sèche à la
chaleur du foyer allumé,
Et de lambeaux épais
couvre sa cicatrice.
La Reine en ce
moment s'adresse au sage Ulysse :
|
|
465 |
La douceur que
je goûte à vous entretenir,
Ne doit plus en ces
lieux long-temps vous retenir,
Et déjà du sommeil
la nuit amène l'heure.
Un seul moment encor
près de vous je demeure ;
Écoutez-moi. Bientôt
vos sens en liberté
|
|
470 |
Pourront d'un doux
repos goûter la volupté.
Pour moi, le
désespoir où mon ame est livrée,
Au sommeil en mes
yeux ne laisse plus d'entrée.
Tant que brille le
jour, entière à mes chagrins,
J'occupe ma douleur
du travail de mes mains ;
|
|
475 |
Quand la nuit dans
les airs tend ses voiles funèbres,
Mon douloureux
tourment s'accroît dans les ténèbres ;
Et mon lit, où je
cherche un repos qui me fuit,
Redouble dans mon
cœur l'horreur qui me poursuit.
Je pleure, je gérais
ainsi que Philomèle,
|
|
480 |
Lorsqu'au sein des
vergers le Printemps la rappelle ;
Sous l'ombrage
fleuri des rameaux renaissans,
Philomèle voltige,
&, par de doux accens,
Fait redire aux
échos ses soupirs & ses plaintes (17);
D'une vive douleur
elle sent les atteintes,
|
|
485 |
En songeant à ce
fils dont sa funeste main,
Dans une affreuse
erreur, a déchiré le sein.
C'est ainsi que je
pleure & soupire sans cesse,
Consultant dans mon
cœur si ma juste tendresse
Doit, respectant ma
gloire & le lit nuptial,
|
|
490 |
Fuir d'un nouvel
hymen l'engagement fatal,
M'attacher à mon
fils, & suivre sa fortune ;
Ou si, le délivrant
d'une foule importune,
Et le laissant
régner où régnoient ses aïeux,
Je dois d'un autre
hymen former les tristes nœuds.
|
|
495 |
Daignez donc
m'écouter, & m'expliquer un songe
Qui redouble la
peine où mon âme se plonge.
Au sein de mon
palais vingt cygnes orgueilleux
Sont sur des flots
d'azur le plaisir de mes yeux.
J'ai cru voir cette
nuit un aigle, au vol rapide,
|
|
500 |
Fondre du haut des
monts sur la troupe timide,
L'égorger & s'enfuir
dans les plaines de l'air.
Cet aspect pour mon
cœur est un tourment amer,
Je gémis éperdue, &
mes Femmes troublées,
En pleurs, autour de
moi, demeuroient assemblées,
|
|
505 |
Quand l'aigle
s'arrêta sur le toit du palais,
Prit une voix
humaine, & calma mes regrets :
Pénélope,
dit-il, rassurez-vous ; ce songe
N'est point une
ombre vaine, un frivole mensonge.
Ces cygnes à vos
yeux retracent vos Amans ;
|
|
510 |
Et moi, rapide
oiseau qui trouble ici vos sens,
Je suis l'Époux
chéri que le Sort vous ramène,
Et j'apporte leur
mort à la troupe inhumaine.
Du sommeil aussitôt
dégageant mes esprits,
Inquiète, je vole à
mes cygnes chéris ;
|
|
515 |
Je les revois encor,
sur des bords de verdure,
Consommant à loisir
leur liquide pâture.
Ah ! répondit le
Roi, ce songe merveilleux
Peut-il à votre
esprit offrir un sens douteux
Ulysse va bientôt
vous l'expliquer lui-même,
|
|
520 |
Vos Amans périront ;
la Justice suprême
Les va tous
entraîner dans la nuit du trépas.
D’un si doux
avenir je ne me flatte pas,
Étranger, dit la
Reine ; & ces divers fantômes
Que la nuit sait
sortir des ténébreux royaumes,
|
|
525 |
Obscurs,
embarrasses, & toujours incertains,
Trompent souvent
l'espoir & les vœux des humains.
Il est, vous le
savez, deux portes pour les songes ;
L'une, faite
d'ivoire est ouverte aux Mensonges ;
Par-là sortent
toujours ces fantômes trompeurs,
|
|
530 |
Qui des mortels
séduits enfantent les erreurs ;
L'autre, où l'on
voit briller la corne transparente,
Est de la Vérité la
porte consolante ;
Et les songes sacrés
qu'elle envoie aux humains,
Leur sont de
l'avenir des messages certains (18).
|
|
535 |
Mais celui dont
l'aspect ; cette nuit m'a déçue,
Hélas ! n'est point
sorti par cette heureuse issue ;
Il ne peut consoler
mon déplorable amour,
Puisque je touche
enfin à ce funeste jour
Qui me verra quitter
ma profonde retraite,
|
|
540 |
Ce palais où je vis
l'Époux que je regrette.
Ma voix va préparer
à mes Amans surpris,
Un combat odieux
dont ma main est le Prix,
Un combat où jadis
l'objet de ma tendresse,
Mon Époux
malheureux, signala son adresse,
|
|
545 |
Quand, saisissant
son arc, son infaillible main
A travers douze
anneaux lançoit un trait certain.
Celui de mes Amans
qui pourra dans la lice
Plier d'un bras
nerveux l'arc du vaillant Ulysse,
Et saura, sans
faillir, ainsi que ce Héros,
|
|
550 |
Faire au trait
empenné franchir ces douze anneaux,
Je lui donne ma foi,
je consens de le suivre (19);
J'abandonne ces
lieux où je ne saurois vivre,
Ces lieux, jadis si
chers à mon fidèle amour,
Et dont l'image
encor, jusqu'à mon dernier jour,
|
|
555 |
Même au sein du
sommeil, assiégeant ma pensée,
Par des songes
cruels me sera retracée.
Reine, dit le
Héros, allez, & sans délais
De ce nouveau combat
occupez ce palais.
Ulysse reviendra,
même avant qu'il commence
|
|
560 |
Avant que ces Amans,
enivrés d'espérance,
Puissent tendre cet
arc qui n'est pas fait pour eux.
Généreux
Étranger, que vous flattez mes vœux
Répondit à ces mots
Pénélope charmée !
Que votre voix est
douce à mon âme alarmée
|
|
565 |
Qu'aisément les
plaisirs d'un entretien pareil
Seroient fuir de mes
yeux les charmes du Sommeil
Mais ce Dieu, qui
tient tout sous sa main souveraine,
Nous dompte dans la
joie ainsi que dans la peine :
Tout mortel doit
payer, soumis aux loix du Sort,
|
|
570 |
Une part de là vie
au frère de la Mort.
Je vous quitte ; je
vais, Épouse infortunée,
Arroser de mes
pleurs ma couche abandonnée ;
Et vous, pour
reposer, dans ce lieu séparé,
Choisissez, ou la
terre, ou ce lit préparé.
|
|
575 |
En son
appartement la Reine se retire,
Ses Femmes l'ont
suivie ; elle pleure & soupire,
Attendant que
Pallas, sensible à ses douleurs,
Par un profond
sommeil ait suspendu ses pleurs.
|
|
Notes, explications et commentaires
(1) Les anciens Critiques ont eu raison de marquer de
l'astérisme seul, en signe d'approbation, ces mêmes
vers qu'on a vus mal-à-propos interpolés au XVI°
Livre, M. Clarke s'est conformé à l'opinion des
Anciens ; mais Madame Dacier, qui ne veut jamais
rien perdre de ce qui porte le nom d'Homère, a
rejeté ce sentiment.
(2) Cette pensée, si déshonorante & si triste pour
l'humanité, n'en est pas moins vraie généralement.
Aussi les Peuples polis de l'antiquité ne portoient
jamais d'armes que lorsqu'ils marchoient contre
l'ennemi. Les Scythes & les Germains étoient
toujours armés.
(3) Le grec dit : celui qui touche à mon boisseau.
Un des préceptes de Pythagore étoit, qu'il ne
fallait pas s'asseoir sur le boisseau : c'étoit
une expression allégorique dont il se servoit
suivant son usage, pour faire entendre que l'homme
ne devoit pas prétendre à être nourri sans
travailler. C'étoit conformément à ce principe,
qu'un ancien Poëte disoit, que l'homme oisif vit
de larcins.
(4) Le texte dit, que ce siége dit travaillé en argent &
en ivoire, & que c'étoit l'ouvrage d'un fameux
Artiste nommé Icmalius, qui y avoit joint un
marche-pied. C'étoit la forme de ces sièges
antiques.
(5) Tout le commencement de la réponse d'Ulysse est une
répétition de ce qu'il a déjà dit à Antinoüs au XVII°
Livre. La réflexion qu'il fait sur son bonheur
passe, n'a pas plus d'étendue ici qu'elle ne doit en
avoir, & c'est ce qui me confirme encore que tout ce
qui se trouve de plus au XVII° Livre a été
interpolé, comme je l'ai déjà observé.
(6) J'ai suivi le sentiment de Clarke, qui interprète
l'expression du texte par une expression analogue du XII° Livre,
σῶ δ άυτὅ κράατι τίσεις,
tuo capite lues.
(7) Si l'on demandoit à quelques discoureurs politiques
quel est le principe fondamental du bonheur des
États, peut-être verroit-on à l'incertitude & à la
variété de leurs réponses, que la maxime d'Homère
n'est pas aussi triviale qu'elle le paroît.
Cependant on auroit peut-être encore lieu d'observer
que, sous des noms divers, ce seroit la justice
seule que les plus sensés Moralistes reconnoîtroient
pour l'unique source de la félicité du peuple ;
celle qui allure les propriétés, qui met chacun à sa
place, qui console le pauvre, en lui faisant espérer
secours & protection, & qui tient les Grands en
bride, en leur faisant craindre les peines infligées
à l'abus du pouvoir. Ce sont ces considérations qui
ont fait dire avec raison, que la justice est la
bienfaisance des Rois.
(8) On trouve ici dans l'original, les mêmes vers qu'on a
vus Pénélope adresser à ses Amans dans le Livre qui
précède celui-ci. Ils paroissent beaucoup moins bien
placés ici, puisqu'Ulysse, en comparant Pénélope aux
plus grands Rois, elle lui parle que des qualités de
son ame, & que Pénélope ne peut pas répondre comme
dans l'original, que les Dieux ont détruit la
beauté. J'ai donc cru devoir changer un peu le
commencement de la réponse de Pénélope, pour la
rendre plus convenable au discours d'Ulysse.
(9) J’ai supprimé tout le récit de cet artifice, que l'on
trouve déjà détaillé dans le II° Livre, & qui m'a
paru un peu trop long ici.
(10) Et le grec ajoute : car vous n'êtes point né d'un
chêne ou d'une pierre. Cette expression, qui
tient absolument au génie de la langue, & qui n'est
qu'une manière d'affirmer cette proposition, car
vous avez eu un père & une mère qui vous ont donné
le jour, a fait faire des conjectures plaisantes
aux Scholiastes. Ils ont imaginé que, comme
d'anciennes traditions portoient que les hommes
étoient sortis du creux des rochers & des arbres, c'étoit
à ces traditions qu'Homère faisoit allusion. Mais
lorsque Platon dit, au VIII° Livre de la
République: « Pensez-vous que l'art de gouverner
soit sorti des pierres & des rochers ! » n'est-il
pas évident que c'est une manière d'affirmer
positivement que cet art a eu des inventeurs, &
n'est pas, comme nous disons, tombé des nues.
Que cette expression françoise vienne à se perdre un
jour, & que des Commentateurs entreprennent de
l'expliquer, on verra de plaisantes imaginations. La
langue grecque est remplie de ces sortes de
locutions, où, par la négation d'une proposition
absurde, on affirme la proposition contraire. C'est
ainsi qu'on trouve dans Homère : Vous n'êtes
point venu a pied sur les eaux, pour dire,
vous êtes venu sur un vaisseau. Mme Dacier admet
le sentiment des Scholiastes, & croit que ces hommes
nés d'un chêne ou d'un rocher, étoient ce que nous
appelons des enfans trouvés.
Plus on étudie Homère, & plus on voit que les efforts des
Commentateurs ressemblent à ceux de la mer sur son
rivage : ils ont découvert un côté pour en couvrir
un autre.
(11) L'île dont il est ici question est l'île de Crète,
fameuse par ses cent villes. Centum urbes
habitant magnas. Énéide, livre III. Les
Scholiastes & les Géographes se sont exerces sur la
difficulté que présente cette différence de
quatre-vingt-dix villes que lui donne ici Homère, au
nombre de cent, qu'il lui donne au II° Livre de
l'Iliade. La véritable raison de cette différence
tient encore au génie de la langue, où le seul mot
cent n'est souvent qu'un nombre indéfini pour
désigner une grande quantité. C'est ainsi que
Thèbes en Égypte étoit nommée la ville aux cent
portes. Au reste, le texte original fait mention des
différens peuples qui habitoint cette île ; c'étoient
les Achéens, les Crétois Autochtones, les Pélasges,
& les Doriens, dont la nation s'étoit divisée en
trois parties, & habitoit trois pays différens,
savoir, le Péloponèse, l'Eubée & la Crète : Homère
ajoute que leur langue étoit mêlée. Il ne faut pas
croire que leur langue fût entièrement différente ;
au contraire, il est vraisemblable qu'elle étoit la
même pour le fond, & qu'il n'y avoit de différence
que par certains mots étrangers qui les
distinguoient, & qu'on a nommés
γλῶσσαυ.
(12) On ne sauroit mieux saisir le véritable esprit de
cette comparaison, que dans ces vers attribués à
Ovide :
Liquitur, ut quondam Zephyris & Solibus ictoe
Solvuntur teneroe, vere tepente, nives.
Consol. ad. Liv. Augusl. Vers 101
J'ai substitué le mot Zéphyre à celui d'Eurus qui
est dans l'original, pour me conformer à nos idées,
& j'ai suivi l'exemple de l'Auteur Latin que j'ai
cité.
Je ne puis m'empêcher de rapporter ici une observation
judicieuse de Foster, dans son excellent Ouvrage
intitulé : Essai sur l'Accent & la Quantité,
pour venger Homère de l'ignorante critique d'un de
ses plus fameux détracteurs. Dans les cinq vers
d'Homère qui peignent la douleur de Pénélope, le mot
τήκω, revient cinq fois, & cependant par la variété de ses terminaisons,
(il auroit pu ajouter, & de la position de
l'accent), il n'a rien de desagréable... Perraut
a traduit littéralement ce passage, & a affecté de
répéter quatre fois le mot liquéfie, pour le rendre
ridicule ; & par-là il n'a montré que son
ignorance, en ne distinguant point la différence
prodigieuse des inflexions de la langue grecque & de
la sienne.
(13) L'original ajoute au mot d'époux une circonstance
infiniment tendre, & qui est rendue avec une
douceur & une grace qu'on ne trouvèrent dans aucune
langue. Je ne puis m'empêcher de la citer ici pour
ceux qui lisent l'original :
κουρίδιον, τῶι τέκνα τέκηι φιλότητι μιγεῖσα
(vers 266)
Ce vers, dicte par le sentiment le plus délicat, répond à
celui-ci du XXIV° Livre de l'Iliade :
Παις δ ἔτι, νηπίος ἄυτως
ῆν τέκομεν σύ, έγώτε δυσάμμορος
On reconnoît dans ces expressions, combien le langage du
sentiment, le véritable langage de la Nature, si
difficile à trouver aujourd'hui, étoit familier à
Homère. Peut-être dût-il en partie ce bonheur à
celui de vivre chez un Peuple extrêmement sensible,
que les vices de la société n'avoient point encore
dépravé.
(14) Tout ce qu'Ulysse va dire ici, n'est qu'une
répétition de ce qu'il a déjà dit à Eumée au XIV°
Livre. Il y a une observation à faire à l'occasion
du naufrage dont il est question, c'est qu'ici il en
parle comme d'un événement arrivé à une autre
personne que lui, au lieu que dans le XIV° Livre il
en parle comme d'un événement arrivé à lui-même.
Mais ce naufrage est censé regarder toujours la
personne d'Ulysse ; c'est après ce naufrage qu'il
aborde sur les terres d'Épire. Je ne conçois donc
pas comment, par les vers qui sont ajoutés ici dans
le texte, Ulysse est censé avoir été chez les
Phaeaciens avant d'arriver en Épire, d'autant mieux
qu'Ulysse, par ce récit tel qu'il est, ne dit pas
comment il passa de chez les Phaeaciens aux bords où
régnoit Phœdon. On peut remarquer encore que,
suivant les vers du texte que j'ai supprimés, Ulysse
dit, que les Phœaciens l'avoient comblé de présens,
& vouloient le ramener à Ithaque sain & sauf ; mais
qu'il avoit mieux aimé aller encore dans d'autres
pays amasser de nouvelles richesses. Cela ne paroît
nullement vraisemblable ; & je ne serois point
étonné qu'il y eût encore ici quelque imagination de
Rapsode, & que les neuf vers qui suivent le 277
eussent été interpolés.
(15) J'ai supprimé ici l'histoire de la blessure d'Ulysse,
que j'ai regardée comme interpolée par les Rapsodes.
Voyez à la fin de l'Ouvrage cette histoire, telle
qu'elle est dans l'original, & les raisons qui m'ont
à peu-près persuadé que c'est une interpolation.
(16) Le grand âge d'Euryclée l'autorise à parler ainsi
d'elle-même, & nous avons vu par la conduite qu'elle
a tenue à l'égard de Pénélope au commencement du Poëme, qu'elle mérite bien un pareil éloge. C'est
ainsi que l'on voit avec étonnement dans Homère,
l'observation fidèle de ce grand précepte de
poëtique, recommandé par Horace : Primo ne
medium, medio ne discrepet imum. Qu'on suive
tous les caractères tracés par Homère, & l'on sera
surpris, au milieu d'une si grande variété de n'y
trouver jamais la moindre discordance, de voir tous
les personnages agir conformément à leurs mœurs, &
de les voir tous si bien liés à la fable, qu'ils y
sont absolument nécessaires avec les modifications
que le Poëte leur a données.
(17) Il paroît assez singulier que des accens aussi
variés, aussi agréables, aussi mélodieux que ceux du
rossignol, aient passé chez les Anciens pour des
accens de tristesse. Seroit-ce que les ames les plus
sensibles, & par conséquent les plus portées à la
mélancolie, sont les plus disposées à écouter ces
chants, & que les Poëtes qui ont inventé la fable de
Philomèle, ainsi que les peuples chez qui elle s'est
d'abord répandue, avoient cette organisation
délicate qui les portoit à s'affecter jusqu'aux
larmes de ce qui ne sait que nous émouvoir
légèrement ? Au reste, la fable qu'Homère a suivie
touchant Philomèle, ne paroît pas la même que celle
que les Poëtes postérieurs ont adoptée ; il n'est
question dans Homère ni de Térée, ni de l'outrage
qu'il fit à la soeur de Philomèle, ni de langue
coupée, ni de toutes les horreurs tragiques dont cet
événement a été chargé dans la suite. Homère dit
seulement qu'Aédon ou Philomèle étoit fille de
Pandarus, & qu'elle tua, sans le vouloir, son fils
Ityle. Qu'on suive ainsi toutes les histoires
mythologiques de l'antiquité, & l'on verra qu'il en
est de ces histoires comme des opinions anciennes, &
que sur un fond souvent assez simple, les Ecrivains
postérieurs n'ont cesse d'entasser une foule d'idées
ridicules, absurdes & barbares.
(18) Cette imagination d'Homère a été consacrée chez les Poëtes Grecs & Latins, mais elle n'en est pas moins
obscure pour ceux qui voudroient connoître ce qui a
pu y donner lieu, Madame Dacier, parmi toutes les
explications qui ont été imaginées de ces deux
portes, en admet une qui lui semble fort
raisonnable. Elle suppose que la corne représente
l'air, à cause de la transparence, & que l'ivoire
représente la terre, à cause de son opacité ; & il
lui paroît évident que les songes qui passent par
l'air ou par la corne, sont des songes envoyés du
Ciel, & qu'ils ne trompent point. Le Traducteur
Anglois a imaginé que cette invention venoit
d'Égypte. Diodore de Sicile, dit qu'il y avoit à
Memphis, la porte de la vérité, la porte de l'oubli,
&c. & qu'Homère, qui avoit emprunté des usages
Égyptiens tout ce qu'il dit des enfers, pouvoit bien
aussi en avoir emprunté tout ce qu'il dit sur les
songes. Mais, peut-être, sans aller chercher si loin
l'origine de cette singulière imagination, ceux qui
lisent l'original, pourroient la trouver dans la
signification des verbes Ελεφαίρονται
& κραινοσι qui, comme on voit, ont une certaine analogie avec les
mots
έλέφας
&
κεράως.
Ce ne seroit pas la première fable uniquement fondée
sur l'abus des mots. Voyez-en une foule d'exemples
dans la Géographie sacrée de Bochart.
(19) L'expédient dont Pénélope se sert pour éprouver ses
Amans & décider son choix, est dans la classe des
possibles ; mais comme il n'etoit pas absolument
nécessaire, il faut convenir que ce moyen que le
Poëte emploie pour amener le dénouement, n'est pas
infiniment heureux. Ce n'est pas ainsi que l'Iliade
marche au dénouement. Tout y est nécessaire, tout y
tient aux passions des personnages. Mais nous avons
déjà dit, dans le Discours préliminaire, quelle
différence il y avoit dans la construction de ces
deux Poëmes.
|
|
|
|